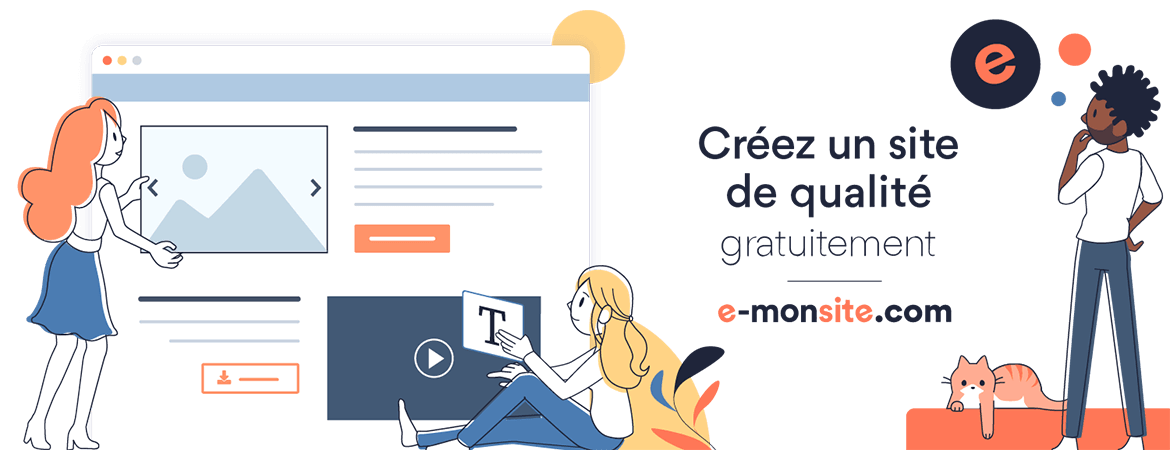Articles de pastekskizofren
Update
- Le 03/12/2020
- Commentaires (0)
- Dans Des fois, j'ai la flemme de crier...
ok salut ce site est en perdition, j'ai rien publié depuis des lustres, mais je veux le garder en tant qu'archive parce que j'aime bcp ces textes et c une partie de ma vie à laquelle je tiens
donc oui, le site est mort, mais je ne le suis pas, suivez-moi sur twitter @Pastek_S
Contrastes
- Le 21/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Coup de Gueule
J'ai une synthèse de 400 mots à écrire pour demain, 16h30.
Qu'est-ce que ça a à voir avec un contraste, me demanderez-vous, et vous aurez raison!
Bah pas grand-chose.
Cette synthèse, je l'ai pas finie, il est 19h. À vrai dire, je l'ai à peine commencée. J'ai lu deux des quatres articles sur lesquels je dois travailler. Parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé hier soir. Je n'arrive pas à mettre de côté tout ça, ces gars, la pluie, la nuit, le froid, les poneys.
Et là, normalement, vous ne comprenez absolument pas de quoi je parle, et c'est normal.
Reprenons depuis le début.
Hier, je me suis rendue à la Suisse Pony's Con, première convention brony de Suisse Romande, et également ma première convention brony à moi. Pour ceux qui ignorent ce qu'un brony, voici une petite explication...
"Brony" est la contraction de "bro(ther)", qui signifie "frère" et de "pony", qui signifie "poney" (duh!). Il s'agit du nom que se donnent les fans masculins de la série animée "My Little Pony: Friendship is Magic". Bon, là, vous devez vous dire que des mâles qui kiffent les poneys, déjà, c'est chelou, et franchement, j'ai pas le courage de me lancer dans une dé-stéréotypisation du fandom. Je vous conseille juste de mater ce documentaire (en anglais, déso ^^) pour piger "mé pk des mec y zaim des truk 2 meuf, c pd lol".
Je partirai donc du principe que vous ne détestez pas les bronies. Voilà.
Je fais personnellement partie du fandom, et je dois avouer que les bronies sont à 95% des gens adorables. Pas mal d'entre eux prennent au pied de la lettre la devise de la série, à savoir que l'amitié est magique. Et si ça peut paraître con, bah, je pense que c'est une plutôt bonne devise... Qui peut franchement dire que se faire des amis, en prendre soin et globalement être gentil est une mauvaise idée?
Vu que je suis une saloperie d'idéaliste, je pense qu'en effet, aimer une personne peut la rendre meilleure (wesh comme Voldemort qu'a pas eu d'amour alors il est méchant tu vois?). Mais cela n'est que mon avis.
Dooooonc! Les bronies sont des gens gentils. Le truc, c'est que le fandom est constitué en partie de gens qui, justement, n'ont pas trouvé cette amitié IRL (=In Real Life, dans la vraie vie). Je parle là de gens un peu asociaux, qui peuvent être mal à l'aise en société, voire se sentir stigmatisés pour aimer une série comme MLP. En même temps, c'est une réalité dans beaucoup de communautés qui se sont formées sur les Internets. Et également, comme beaucoup de communautés web, le fandom brony est constitué en très grande majorité d'individus masculins.
Et c'est là que ça commence à être intéressant. Parce que plonger une meuf comme moi qui porte un cosplay d'un perso féminin d'une série, potentielle waifu (=wife prononcé à la japonaise, un perso de fiction qu'on aime d'amour) kiffée par des 15-30 ans mâles dans une convention essentiellement constituée desdits mâles... s'est étrangement bien passé!
Pas de commentaires graveleux, pas de drague lourde. Un respect incroyable. Y'en a juste un qui après m'avoir parlé 5min m'a demandé mon Facebook (que je lui ai pas donné lolilol). Je voyais bien que certains en papotant avec eux avaient un objectif autre que la simple camaraderie, mais ils étaient toujours respectueux et sympas. Même ceux qui étaient clairement dans une optique "flirt" restaient vraiment cools. C'est des dalleux, mais pas lourds.
Après, il ne s'agit que de mon expérience dans une toute petite communauté, je ne sais pas comment est le fandom IRL ailleurs, mais là, je me sentais en sécurité, et appréciée pour ma conversation/mon humour/mes persos préférés/comment j'avais fait mon cosplay.
J'étais considérée comme un être humain. Et ça a boosté ma confiance en moi, au point que j'ai même osé m'élancer sur la piste de danse, chose que je n'avais absolument jamais faite (oui, moi aussi je suis le cliché de l'asociale qui se trouve des potes sur le net ^^).
Donc, en sortant de la convention, en montant seule dans le train après l'avoir attendu en compagnie d'un autre brony qui avait un GPS pour trouver la gare (et qui partait dans l'autre sens), je me sentais bien. J'avais confiance en moi, mais à un point que je n'avais jamais atteint. J'étais juste heureuse, quoi. C'était vraiment une chouette convention, et j'échangeais des sms avec un gars auquel j'avais donné mon numéro.
Mais, malheureusement, on dirait que certains ne comprennent pas le concept de respect et ne savent toujours pas que les filles sont également des humains.
À l'arrêt de train précédant celui où je devais sortir, un groupe d'ados bourrés est monté.
Le train que je prenais avait deux étages. Par habitude, je suis montée au premier, car il y a moins de passage et de monde. Je me réjouissais, car il pleuvait et il faisait nuit (il était 23h30) et j'adore marcher de nuit, dans le calme, en écoutant le bruit des gouttes d'eau sur mon parapluie. C'est un de mes petits plaisirs dans la vie.
Donc, ces ados sont montés dans le train, et je vous ai menti, il y avait deux groupes. Les deux groupes sont montés à l'étage en hurlant, avec de la musique à fond, encore des bouteilles à la main, et y'en a même un qui fumait (même si c'est interdit dans les trains). Chaque groupe s'est posé d'un côté du wagon, je serais donc obligée d'en traverser un pour pouvoir sortir. Vu que je suis plutôt tolérante (ils sont jeunes, ils s'amusent, ils sont saouls mais pas méchants), je me suis contentée de me plaindre intérieurement du bruit qu'ils faisaient et de les ignorer en jouant sur mon téléphone.
Malheureusement, le groupe qui était le plus proche de moi (et qui était aussi le plus petit, et donc celui que j'avais stratégiquement choisi de traverser en descendant plus tard du train), a commencé à m'appeler, à essayer d'attirer mon attention. Je ne leur ai rendu que mon indifférence, j'avais juste envie de rentrer chez moi et de dormir, pas de parler politique étrangère avec un mec de 16 ans bourré.
Plus les minutes passaient, plus ils devenaient chiants. J'ai donc opté pour une stratégie de repli, et suis descendue de l'étage d'un pas que je voulais dynamique et assuré.
"Houuu! Elle est vénèèèèèère! Hoo! Mais c'est la pire!"
Oui, j'étais vénère, on peut pas voyager en paix, putain? Je me suis postée devant la porte, en attendant d'arriver (encore trois minutes avent la gare!). Le petit groupe est descendu aussi. Ho non, ne me dites-pas qu'ils descendent au même arrêt que moi, ai-je pensé.
"Allez! T'est la pire! Hé! *siffle* Hé!"
L'un d'eux s'est placé juste derrière moi, je pouvais sentir qu'il n'était qu'à quelques centimètres de mon dos. J'ai encore choisi l'arme de l'indifférence. L'autre s'est planté juste en face, en empiétant copieusement sur ma sphère personnelle. Il a ouvert les bras en souriant comme un connard.
"Allez! Viens on s'embrasse!"
Non. Non. Non. Je voulais juste me barrer, je commençais à avoir peur. Ils étaient plusieurs, j'étais seule, c'est tard, je veux rentrer à la maison. Et l'autre derrière qui m'a tapé sur le cul. Non non non non non!
On arrive en gare, enfin!
"Non mais, fous-moi la paix, j'te connais pas.", ai-je lancé avec le plus d'assurance possible avant d'abandonner le navire (oups, c'est un train) en marchant le plus vite possible.
"Hooo! C'est la pire, la piiire! J'te connais pas!"
J'ai entendu qu'on crachait dans ma direction. Connards.
Il y avait pas mal de monde qui descendait du train, essentiellement des jeunes comme ceux qui m'emmerdaient, mais j'ai choisi de traverser les groupes pour rentrer le plus vite possible chez moi. Ils m'ont suivie, ces salauds.
Le chemin que je dois prendre est très mal, voire pas éclairé (merci la campagne!) et je les entendais toujours crier "Héééé!" dans ma direction. J'avais peur, je me suis mise à courir, en trempant de pluie mon joli poster acheté à la convention. Connards.
Je les ai semés, je crois. Dans le doute, j'ai gardé mon couteau suisse à la main jusqu'à chez moi.
Toutes les deux secondes, j'avais l'impression d'entendre de pas derrière moi, de les voir dans la nuit. J'avais peut, je tremblais, peut-être à cause du froid, peut-être à cause du stress.
Je m'en suis voulu. Pourquoi est-ce que je rentrais si tard, j'aurais dû porter autre chose qu'un jean slim, et si j'avais eu un grand manteau?
NON! C'est eux qu doivent s'en vouloir! Je n'ai rien fait de mal, je voulais juste rentre chez moi, c'est pas mes habits les fautifs, c'est eux! Je ne peux pas me balader toujours avec mon père, mon frère, mon cousin ou mon mari putain! NOOOOON! J'ai le droit de prendre le train quand je veux, seule, et de ne pas me faire agresser parce que ho! J'ai voulu sortir ce soir -là! MAIS QUELLE BANDE DE CONNARDS.
JE NE SUIS PAS UNE PROIE!
C'était la première fois que je subissais du harcèlement dans les transports publics.
Je sais que ce ne sera pas la dernière.
Vous le voyez, le contraste, maintenant? Entre ces garçons qui savent respecter celleux qu'ils dragouillent, et ces connards qui voient les filles comme des proies aussitôt qu'elles ont l'outrecuidance de mettre un pied dehors?
Si des bronies dans une communauté à 90% masculine sont capables d'être respectueux quand ils rencontrent une fille, pourquoi pas vous?
Il ne tient qu'à vous de faire en sorte que je puisse à nouveau avoir du plaisir à marcher la nuit, sans me retourner nerveusement à chaque bruit de pas que mon imagination me fait entendre.
L'Histoire d'Ana
- Le 21/10/2016
- Commentaires (0)
- Dans Historiettes
/!\ Violence, persos un peu zinzins et un peu malsains
_______________________________________
Ana travaille à la boulangerie du coin de la rue. Elle s’occupe de la caisse, vend des croissants aux petites mémés du quartier. Un bien joli quartier d’ailleurs, idyllique. Il n’y a presque pas de voyous, juste quelques ados un peu paumés qui zonent les vendredis soir. Il y a de jolies fleurs sur les balcons, les gens sont serviables et, s’il arrivait à l’un d’eux d’oublier ses clefs sur la serrure, il est sûr en rentrant le soir que quelqu’un les aura gentiment confiées à la concierge. Ana déteste ce quartier.
À chaque fois qu’elle passe devant l’école primaire à l’heure de la récréation, Ana a le cœur qui se serre. Ces enfants qui jouent dans la cour, ces cris et ces gosses qui courent, qui rient, ils résonnent fort dans son esprit. Elle les enregistre dans son oreille, les réécoute, les chéris. Elle reste figée de longues minutes, à les observer, derrière les grilles de l’école. Elle a une sensation étrange dans le ventre. Ana déteste les enfants.
Lorsqu’elle rentre chez elle, vers cinq heures, Ana emporte avec elle un peu des invendus du jour. Avec Max, son fiancé, ils mangeront des pains à la vanille pour le dessert, encore. Elle rentre tôt, car dans son petit ménage idéal, c’est elle qui fait la cuisine, et qui attend son amoureux pour sortir le gratin tout chaud du four, et le poser sur la table, servir et enfin manger, dans ces assiettes Ikea qu’ils ont choisies ensembles lorsqu’ils ont emménagé dans ce petit appartement de banlieue. Ana déteste autant les pains à la vanille, que Max, que les gratins. Et surtout, elle ne peut plus voir les assiettes Ikea.
Ana est malheureuse. Et bien perspicace serait celui qui devinerait pourquoi. Elle a pourtant tout pour être heureuse. Un fiancé gentil, calme et intelligent, un travail enviable, un appartement décoré avec goût (et sans trop se ruiner en plus !) et en plus, elle est bonne cuisinière. Que demander de plus ? La seule chose qui pourrait manquer, dans ce couple parfait, ce serai un enfant. Car Ana aura trente ans en Mars, et il serait peut-être temps d’agrandir la famille, lui dit toujours Tata Gisèle.
Mais Ana ne peut pas avoir d’enfant. Elle n’en est pas capable, ne s’en sent pas capable. Elle ne le veut pas. Elle déteste les enfants. Ana les hais, les abhorre, les maudit, car ils sont la cause première de son malheur. Ana déteste les enfants. Elle le dit haut et fort, très fort, comme pour se justifier.
La vie s’écoule doucement, dans cette petite banlieue aux balcons fleuris. Les feuilles tombent, l’hiver approche, puis les immeubles se couvrent de guirlandes et de Pères Noël en plastique. Encore quelques semaines, et ce sont les bonshommes de neige qui commencent à déambuler dans le parc.
Au milieu de l’hiver, les voisins entendent un soir de la vaisselle se casser, chez Max et Ana. Des cris, des pleurs. C’est une dispute. Leur première dispute. Max aime les enfants, il voudrait tant un jour tenir dans ses bras cette petite chose rose et fripée qu’on appelle un bébé. Il a voulu encore une fois tenter de convaincre Ana. Mais on ne sait comment, tout cela a dégénéré.
Dans le froid, sous la neige qui tombe dru, Max part, en emportant sa tasse favorite, son pyjama, sa brosse à dent et deux caleçons. Il retourne chez sa maman. Ana commence le lendemain à mettre les affaires de son fiancé dans un gros carton. Il viendra les chercher plus tard.
Ana et Max se sont séparés. C’est bien sûr de la faute de Ana, elle le sait, elle le sens, elle se dit qu’elle n’est pas normale, qu’elle ne vaut pas grand-chose. Rien, même. Ce soir-là, Ana prend la lame d’un rasoir et coupe trois grands coups dans son avant-bras, dans le gras, là où ça fait mal et où ça saigne. Elle ne veut pas mourir, juste se punir de n’être qu’un aussi médiocre être humain, d’exister et d’être malheureuse, d’avoir tout gâché.
Ana s’en veut, Ana s’enferme. L’appartement est bien vide maintenant, et elle arrête de travailler.
Ana ressasse. Ana rumine. Sa frustration et son désespoir grandissent.
Elle n’était déjà pas très loquace, et plutôt étrange, mais en ce début de printemps, son seul contact avec l’extérieur était le journal, qu’elle ne lisait même plus.
Personne ne la voit plus. Sauf la concierge, qui sonne un jour chez elle. Ana ouvre la porte. Elle a les cheveux sales, porte un pull à capuche démesuré, des pantoufles mitées et a les yeux hagards. On peut voir que l’appartement est sombre, les stores sont baissés. Ça sent le renfermé.
Après un instant d’hésitation, la concierge lui livre la raison de sa visite. Les parents du petit Jon sont désespérés. Le garçon a disparu. On l’aurait vu pour la dernière fois acheter des croissants à la boulangerie, auprès de la remplaçante d’Ana, une semaine auparavant. Il revenait de l’école et s’y achetait un goûter. Il a disparu entre la boulangerie et chez lui, à l’étage du dessus.
Ana réagis à peine. Elle remercie la concierge de l’avoir prévenue et ferme la porte. Elle reste cependant l’oreille collée contre le bois, à écouter le pas léger de la vieille dame qui retourne dans sa loge. Le son devenu un écho lointain dans la cage d’escalier, elle se laisse glisser à terre dans un soupir. La pièce est un véritable désastre. En désordre, du scotch, de la ficelle, des draps sales et des boîtes de pizza vides jonchent le sol.
C’est pas passé loin.
Ana traîne des pieds jusqu’à la dernière chaise encore debout. Sur la table, une bouteille de vodka presque vide et un verre plein de traces de doigts. Elle se sert et bois en regardant dans le vide.
« Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? »
Ana regarde ses mains sèches et ses ongles cassés, ses avant-bras, ses trois cicatrices, son verre qui se vide.
L’air est lourd, vicié. Elle n’a pas aéré la pièce depuis un moment déjà. Peut-être une semaine ? Deux ?
Si encore elle était seule, cela ne la gênerait pas, mais il est impoli d’avoir une maison qui pue lorsque l’on a un invité ! Ana se met à rire doucement. Elle finit son verre et se lève mécaniquement. La cuisine elle aussi est sombre. Elle fait mine d’allumer la cuisinière, et se rappelle qu’elle n’a aucun ingrédient ni dans son frigo, ni dans son placard. Elle se réduit à commander deux pizzas par téléphone à un vendeur à la voix instable.
Les pizzas arrivées, elle paie le livreur avant de lui claquer la porte au nez. Pas que ça à faire. Elle vérifie le contenu des boîtes. Une Margherita et une au jambon. Il aime bien la pizza au jambon. Elle pose la première boîte sur la table à manger avant de se diriger vers sa chambre. Elle sort la clef du fond de sa poche et ouvre la porte.
« Tiens. Manger. »
Elle pose la pizza sur le lit avant de repartir dans le salon, en prenant soin de refermer à double tour. Est-il seulement encore vivant ? Oui, il avait mangé la pizza précédente. Mais pourquoi reste-t-il caché sous le lit ? Ana ne veut pas le brusquer, elle ne veut pas lui faire de mal, mais elle ne comprend pas pourquoi il ne veut pas lui parler, ni la regarder. Elle se demande d’ailleurs de quoi elle a l’air. Lui a-t-elle fait peur ?
Devant le miroir des toilettes, Ana se reconnaît. Ha ! Mais oui ! Cela doit être cela, sa vraie forme. Pas la fifille pomponnée et toute gentille qu’elle paraissait être avant, non, un monstre, une liche, un zombie, une chose infréquentable, c’est cela qu’elle est en réalité. Elle a bien fait, bien fait, bien fait de tout envoyer valser. Elle se sent sincère, pleine, calme. Plus rien à voir avec avant. Ana ris à nouveau.
Si seulement cette peur et cette angoisse sourde pouvaient se taire. Si quelqu’un entrait dans l’appartement, si quelqu’un entrait dans sa chambre, tout serait foutu, tout serait brisé.
On gratte. À la porte de la chambre. Elle ouvre la porte et il file vers les toilettes. Ana en profite pour remplir à nouveau la carafe d’eau sur la table de nuit.
« Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ?»
Elle retourne s’affaler sur la chaise de la cuisine. Lorsqu’elle l’entend se laver les mains, elle se relève, et lui propose de regarder un film avec elle. On dirait qu’il accepte, mais elle n’en est pas sûre, et à vrai dire, qu’il soit d’accord ou pas, elle s’en fout. La seule personne qui compte maintenant, c’est elle. Elle l’a bien mérité, après avoir tant souffert. Le mérite, le mérite, oui, elle a le droit de penser à elle, aussi. Elle ne va pas continuer à souffrir, à ressentir toute cette frustration juste pour faire plaisir aux petites mémés qui lui achetaient des croissants, pour sa mère, pour son mec, pour qui ? Qui aurait le droit de lui dicter quoi faire, à part elle-même ?
Elle avait fait sa révolution, sa crise de la trentaine, un caprice, juste un, pour une fois. Quand on garde la pression confinée, quand on attend aussi longtemps, c’est forcément que… oui. C’est… elle a le droit ! Le droit ! Elle n’a pas besoin de se justifier ! Elle est enfin elle-même, elle-même, elle-même !
Elle le saisit, il se débat, elle le balance sur le canapé avant de le serrer dans ses bras en riant. Elle est heureuse, oui !
Il sanglote doucement, il n’a pas l’air bien. Elle lui caresse doucement les cheveux en souriant. Il est si beau, sa peau si douce, et sa voix timide et ses yeux grands et brillants, et ses mains… il est parfait, il est si adorable. Il cesse de pleurer et a le regard éteint, il est amorphe, vidé.
« Tout cela ne pourra pas durer éternellement. »
Elle prépare sa valise.
« Viens, on va faire un tour. »
Six mois ont passé. Ana a déménagé depuis longtemps, et son appartement est vide. D’après la concierge, elle a dû partir dans une sorte de clinique où d’asile. Elle était devenue complètement folle, la pauvre. À s’enfermer chez elle comme ça, tout le monde se faisait du souci ! Elle avait l’air complètement abattue. Morte. Inanimée.
Au moins, on avait fini par retrouver le petit Jon ! Oui, il était en train d’agoniser au fin fond de la forêt, coincé dans un ravin et était décédé de ses blessures à l’hôpital, mais au moins, ses parents étaient fixés. Eux aussi avaient déménagé.
La petite banlieue idyllique et tranquille a repris son train-train. Les enfants jouent dans la cour de l’école, et la nouvelle vendeuse de la boulangerie fait la conversation aux petites mémés.
Oui, décidément, c’est un lieu où il fait bon vivre.
Et la radio de la concierge crachote.
« Un corps retrouvé flottant sur le fleuve a été repêché par la police. Il s’agit du cadavre d’une femme, portant un pyjama vert. La police a lancé un appel à témoins et la procédure d’identification est en cours. Un embouteillage s’est formé entre… »
Virginité
- Le 11/10/2016
- Commentaires (0)
- Dans Coup de Gueule
Ceci est la transcription très peu exacte (à vrai dire complètement modifiée afin de servir mon propos) d'une conversation avec un sympathique jeune homme de ma connaissance, sur le sujet, vous l'aurez deviné, de la virginité (wesh je parle de cul mtn lol).
- Du coup, t'es puceau?
- Ouais.
- Et tu pense que tu pourrais coucher avec une meuf plus expérimentée?
- Ce serait bizarre...
- Pourquoi?
- ...
- Une fille pas vierge, c'est mal?
- Je sais pas
- Et pis d'abord, c'est quoi, la virginité, pour une fille?
- Bah c'est quand elle a pas couché.
- Avec un mec?
- Ouais.
- Du coup, une lesbienne, elle est vierge toute sa vie?
- Heuu... Ouais... Non?
- Changeons de perspective... Mettre un tampon, c'est "perdre sa virginité"?
- Bien sûr que non!
- Un doigt en mettant son tampon?
- Non!
- Du coup, si c'est pas mon doigt, mais celui de quelqu'un d'autre?
- Ha bah logiquement, non.
- Alors, si un doigt ou un tampon, "ça va", les outils d'un gynéco, ça compte ou pas?
- Je pense pas, non...
- Et si c'est un autre genre d'outil, genre un sextoy, ça compte? Si une meuf se masturbe pépère avec un sextoy, elle est plus vierge?
- Je pense que si en fait...
- Et si c'est une autre personne qui manipule le sextoy?
- Bah c'est comme pour le doigt?
- Ouep. Et si un sextoy manipulé par quelqu'un d'autre, ça compte pas, pourquoi une bite, ça compterais?
- Ho merde...
- Bé voilà. Vierge ou pas, ça veut rien dire. À la limite, tu peux dire que quelqu'un est plus expériementé, mais juste "vierge", c'est tout pourri.
- Ok, alors en fait, vous autres les féministes, vous êtes pas des hystériques cheloues en fait!
- OUAIS! MORT AU PATRIARCAT! *s'envole comme Superman*
Dommages collatéraux ou le curieux voyage d'un ectoplasme #6 FIN
- Le 09/03/2016
- Commentaires (0)
Et c'est déjà la dernière partie :O
____________________________________
Je retourne au camp. Y a-t-il encore de ces « migrants » là-bas ? Quelques-uns de ceux qui décident de pousser plus loin le voyage mais qui ne touchent jamais leur but. Perdus ou morts.
Si je retourne au camp, trouverai-je un hôte qui voudrait prendre un autre chemin ? Sans doute. J’espère que je n’aurai pas le mal de mer…
Je monte dans la vapeur et me laisse porter par le vent. J’en profite pour me reposer un peu. Je devrais regagner mon propre corps bientôt, je suppose que la nourriture qu’ingèrent mes personnages ne suffit pas à me donner assez d’énergie. J’ai faim et la nuit tombe.
Je somnole jusqu’à voir des carreaux de lumière jaune sous moi. Alors je me laisse descendre. Quelques tentes ont déjà éteint leur lampe, d’autres brillent encore. J’erre un moment entre les toiles. On entend des conversations qui filtrent à travers le tissu et les bâches. Le sol est boueux, il a dû pleuvoir. L’air est froid, mordant et les rares personnes qui sortent sont emballées dans des couvertures en laine, celles qui grattent.
Je me dirige vers la tente médicale, celle qui a un petit chauffage au gaz et dont émane une odeur incongrue de désinfectant.
Il fait déjà meilleur à l’intérieur. La tente doit faire cinq mètres par trois et il y a une demi-douzaine de lits, ce qui me paraît peu par rapport au nombre de tentes dehors. Deux lits sont occupés. Dans l’un, une femme âgée qui ronfle, et dans l’autre, un enfant d’une douzaine d’années, assis, qui boit ce qui paraît être une soupe dans un bol en métal. À ses côtés, un homme d’âge moyen, qui lui ressemble beaucoup. J’en déduis qu’il s’agit de son père. Un peu plus loin, en train de fouiller dans une caisse en plastique, un blondinet en blouse blanche grommelait des jurons en suédois. Il finit par sortir la tête de la caisse en brandissant une boîte de médicaments avec une exclamation de joie. Il sort une pastille de la boîte et la donne au garçon après l’avoir diluée dans un verre d’eau.
J’hésite. Dois-je voir ce que vit ce médecin, ou bien directement entrer dans la tête du père ou du fils ? Le médecin ne bougera pas du camp avant un bout de temps, c’est sûr. Mais le père et le fils ? Peut-être qu’ils vont rester ici aussi… Mais la probabilité qu’ils s’en aillent est plus élevée. J’irai donc avec eux.
Vous connaissez la procédure, maintenant. Il souffle, inspire, j’entre et m’installe. Le garçon est bien son fils. Il est malade, ses poumons ont été touchés par du gaz de chlore. Je m’inquiète pour mon petit Samir. Il est tout ce qu’il me reste, mon fils unique. Sa mère est morte lorsqu’il était encore tout bébé, et je l’ai élevé seul. Parfois, il me demande, comme aujourd’hui, de la dessiner. Je sais que cela lui met des étoiles dans les yeux, et je n’ai jamais voulu lui cacher qui était sa mère. Quand je lui parle d’elle, je me sens un peu triste, mais il a le droit de savoir d’où il vient. Je lui raconte notre rencontre, notre mariage et le bonheur qu’il nous a apporté.
Quand la guerre a commencé, nous avons décidé de rester chez nous, et d’espérer que tout s’arrangerait. Mais le jour où notre quartier a été bombardé au gaz de chlore et que beaucoup de nos voisins sont morts, nous avons décidé de partir. Quant à Samir, il a respiré ce gaz alors qu’il jouait à l’extérieur de l’immeuble, et sa respiration est devenue de plus en plus difficile depuis.
Nous avons voyagé en bus jusqu’à la frontière, et avons atteint le camp il y a deux mois.
Aujourd’hui, mon fils a beaucoup toussé, alors nous sommes venus dans la tente médicale, pour voir si le médecin pouvait faire quelque chose pour lui. Là, il lui donne un médicament à boire.
- Samir ?
Il tourne la tête vers moi, ses yeux ressemblent à ceux de sa mère, je suis sûr qu’il sera un très bel homme une fois adulte.
- Samir, est-ce que tu veux rester au camp ? J’ai pensé que nous pourrions essayer d’aller ailleurs. On prendrait le bateau, tu aimes le bateau n’est-ce pas ? Il y a un gars qui m’a proposé une place sur celui d’un de ses amis qui partira bientôt. Il m’a même proposé une place dans un bus qui va jusqu’au port.
- C’est loin ?
- Oui, plusieurs centaines de kilomètres, ça nous prendra quelques temps pour y arriver. Mais peut-être qu’en Europe, on trouvera de quoi te soigner correctement.
Je lui ébouriffe les cheveux en souriant. Il a l’air de réfléchir, puis finit par acquiescer.
- Tant que tu me laisse pas tout seul, ça va. On part quand ?
- Demain matin, très tôt. Je te réveillerai, ne te fais pas de souci, mon grand. On va sortir d’ici. Tu iras dans une belle école une fois en Europe.
Il fait la moue, aucun enfant ne se réjouit véritablement à l’idée d’être enfermé dans une salle de classe, même si c’est totalement nécessaire.
- Je ne sais pas si c’est vraiment une bonne idée de passer par la mer… C’est dangereux, il y a pas mal de risques de tempêtes en cette saison… et vous êtes sûr que votre homme est fiable ? Loin de moi l’idée de vouloir vous empêcher de partir, mais beaucoup de gens qui voulaient passer par la mer n’ont jamais pu atteindre l’Europe. Entre les garde-côtes, les coquilles de noix sur lesquelles on vous embarque et le prix exorbitant que demandent les passeurs…
C’est Tom qui a parlé. Il est inquiet, ça se voit. Mais nous n’avons pas le choix, si nous voulons continuer. Les frontières terrestres se ferment les unes après les autres, le voyage par la mer sera plus rapide. C’est ce que je lui réponds.
- Très bien, faites comme vous voulez… Mais prenez au moins quelques médicaments pour votre fils. S’il se mettait à tousser plus fort, essayez de lui faire respirer de l’air bien frais. Il est hors de question qu’il reste enfermé à respirer de l’air vicié. Prenez soin de ses poumons, je vous en prie. Il est fragile.
Il me tend la boîte de comprimés que j’empoche. Puis je retourne dans la tente qui nous sert de dortoir, à moi ainsi qu’à une vingtaine d’autres. Samir est resté dans la tente-hôpital.
À l’aube, je vais réveiller mon fils, puis nous retrouvons le passeur à la sortie du camp. Ce n’est pas véritablement un bus qui va nous emmener, plutôt un camion à bestiaux. Je dois payer d’avance les six cent mille livres syriennes que coûte le voyage. Toutes nos économies y passent.
Nous sommes une cinquantaine dans le camion, un vieil engin toussotant et rouillé.
Nous roulons longtemps. Tantôt somnolant, tantôt nous accrochant de toutes nos forces au plancher lorsque les routes sont remplies de nids-de-poule. Je réussis à négocier avec un vieil homme rachitique un verre d’eau pour faire prendre son médicament à Samir, qui commence à s’impatienter.
- On est presque arrivés ?
- Oui… Peut-être… Je ne sais pas… Je ne crois pas…
Nous finissons par arriver au port. En sortant du camion, nous sommes éblouis par le soleil. La coque de noix sur laquelle nous devons embarquer est juste devant nous. Et le bateau est encore plus vieux et rouillé que le camion. Le capitaine se dispute avec le chauffeur à propos prix que nous avons payé, et exige un supplément. Ils sont à deux doigts d’en venir aux mains lorsque le chauffeur accepte de sortir une liasse de billets de son portefeuille. Le capitaine l’empoche et nous fais signe de monter dans le bateau. Ça a l’air d’un vieux chalutier, qui sent encore le poisson. Il y a déjà foule sur le pont, et la cale est pleine aussi. Nous trouvons une petite place près du bras mécanique qui sert à tenir les filets. J’essaie d’estimer le nombre de personnes sur le navire. Cent ? Deux cent ? Beaucoup, et il y en a encore dans la cale. Le bateau finit par partir, l’air lourd.
Nous naviguons plusieurs heures sans soucis. J’utilise mon sac à dos comme coussin, à la fois pour éviter qu’on me le vole et pour tenter de rendre le sol un peu moins inconfortable. Samir joue à lancer des petits cailloux contre une feuille de papier suspendue avec deux autres enfants. Lorsque la nuit tombe, nous nous endormons couchés par terre. Certaines personnes autour de nous ont des tapis ou de petits matelas de camping. Nous, notre seul matelas, c’est le sol. Nous nous endormons facilement, épuisés par le voyage en camion.
KRAAAAK !
Au milieu de la nuit, c’est un choc violent qui nous réveille. Comme un tremblement de terre. On entend des gens qui crient. Que se passe-t-il ? Quoi ?
Dans la pénombre, j’aperçois à tribord une gigantesque silhouette. C’est un autre bateau. Nous avons heurté un autre bateau. Un gros.
Ne nous avait-il pas vus ? On dirait que nous naviguions sans lumières. Le chalutier commence à pencher. Tout le monde est réveillé maintenant, et ça crie ! Ça crie de tous les côtés ! Samir a la main crispée sur mon pull, les yeux écarquillés.
Le bateau s’enfonce, tremble, penche sur le côté. Il va tomber ! Il faut bouger, il faut s’échapper ! Le bateau va chavirer ! Des gens sortent en masse de la cale, et on les entend crier que de l’eau entre. Que faire ? Où aller ?
Il y en a qui sautent dans à la mer avec une des rares bouées de sauvetage présentes sur le bateau. Je me précipite vers l’une d’entre elles qui traîne encore et la fourre dans les bras de Samir.
« L’eau risque d’être froide. Aussitôt que tu seras dedans, je vais te demander de nager le plus loin possible du bateau, et de bien t’accrocher à la bouée, ne la lâche sous aucun prétexte, d’accord ? Je te rejoins dès que possible. Ne laisse personne, jamais personne, te la prendre ! »
Je l’attrape par la taille et le lance par-dessus la balustrade avant qu’il ait pu prononcer un mot. Il crie avant de toucher la surface et je l’entends m’appeler. Le bateau penche encore plus, je glisse, dérape. Il faut que je saute, il faut que je rejoigne Samir, mais le bateau penche du mauvais côté et m’éloigne toujours plus de l’eau.
Je me tiens à la rambarde un moment. Le pont est vraiment très en pente, maintenant, et l’eau commence à le recouvrir dans un gros bouillonnement, juste de l’autre côté.
J’ai peur. Il faut que je trouve un moyen de rejoindre Samir. Il le faut à tout prix ! Il faut que l’emmène en Europe et qu’il aille dans une jolie école.
Je m’accroche de toutes mes forces à la rambarde, mais le pont est trop glissant, et je finis par complètement déraper. J’ai peur. Je suis presque suspendu par les bras. Je commence à fatiguer et soudain, mes mains lâchent prise sans que je leur aie rien demandé. Je me vois glisser au ralenti le long du plancher. Un choc, une douleur aigue, je viens de me cogner la tête contre un de ces morceaux de métal qui sert à enrouler les cordes. Je perds connaissance.
C’est le contact violent avec l’eau qui me réveille. Fraîche. J’ai mal à la tête, et je sens que je saigne. Je suis juste à côté du bateau, qui est complètement renversé sur le côté. Je suis épuisé. Je coule une fois, remonte. Je vois le gros navire un peu plus loin, et des canots qui voguent dans notre direction. Je veux crier, j’avale de l’eau, tousse, avale plus d’eau. Je coule à nouveau. J’ai mal, mal, mal… Je remonte encore une fois, cherche quelque chose à quoi m’accrocher. Rien. J’essaie de respirer, prend une goulée d’air humide et salé. Mes habits imprégnés d’eau ne font que me tirer vers le fond. Les canots se rapprochent trop lentement. Je coule encore, je n’arrive plus à remonter. Mon sac à dos et mes habits mouillés m’entraînent. Il fait noir et trouble sous l’eau, mes yeux me piquent. Je me débats le plus que je peux, mais ne parvient pas à remonter. Samir, je dois remonter m’occuper de Samir.
Mes poumons me brûlent comme si j’avais respiré des braises. Samir ! Je crie, ce n’est qu’une flopée de bulles qui s’échappe. Je veux de l’air… de l’air…
Je commence à voir des petites taches apparaître dans mon champ de vision. Des taches colorées qui dansent. Mes poumons décident d’oublier que je suis entouré d’eau et inspirent. C’est un liquide frais qui entre et calme un peu la brûlure, avant de me faire tousser, et inspirer encore plus d’eau. Les taches deviennent de plus en plus nombreuses, grandissent.
Je cesse de me débattre. Je ne m’en sortirai pas.
Je me laisse couler. J’espère que Samir ira bien. Qu’il pourra trouver une personne plus compétente que moi pour s’occuper de lui. Quel misérable père je fais ! Laisser mon fils tout seul maintenant. Juste quand il a besoin de moi. J’aurais dû écouter le médecin. Cette voie était trop dangereuse.
Je ferme les yeux.
Je ne peux pas rester ici, je ne veux pas finir au fin fond de la Méditerranée. J’ai encore quelque chose à dire ! Il faut que je sorte d’ici. Je me glisse dans l’eau salée des poumons et me propulse vers le haut. Je suis légère, si légère que je remonte sans difficulté, mais en jetant un dernier regard au corps qui coule et bientôt se fait engloutir par le bleu-noir profond de la mer nocturne.
Je crève la surface sans provoquer une seule éclaboussure.
Le spectacle est désolant. Le chalutier sombre doucement alors que des dizaines de gens barbotent autour, accrochés à des bouées ou à des sacs qui flottent. La mer est calme, et je vois au loin des bateaux de garde-côtes qui arrivent à toute vitesse.
Où est le petit Samir ? Il y a tant de monde dans l’eau que je ne parviens pas à le trouver. J’espère qu’il va bien.
Il est temps pour moi de me retirer. J’ai vu assez de mort pour cette fois. Je commence à en avoir assez de voir tout cela. Vraiment assez.
Mais retourner dans mon corps et reprendre ma vie normale et banale, ne plus voir tout cela, ça ne va pas faire disparaître le problème. Je serais juste en train d’enfoncer à nouveau la tête dans le sable, redevenant une ignorante comme je l’étais au début.
À quelques heures de voiture de chez moi, il y a des gens qui se noieront toujours en voulant simplement toucher du doigt une ronde d’étoiles sur fond bleu.
À quelques heures de train, il y a des foules compactes, hommes, femmes et enfants, qui se presseront toujours contre un mur surmonté de barbelés, car on leur avait dit qu’il y avait un trou dans la barrière à cet endroit-là. Déçus, ils finiront par marcher sur les autoroutes.
À quelques heures d’avion, il y aura toujours des gens qui mourront, se sacrifiant pour ce qu’ils croyaient juste, mais qui, au final, seront toujours tous plus manipulés les uns que les autres par la soif de pouvoir de quelques beaux parleurs.
Je ne peux pas oublier ce que j’ai vu. Même si je ne sais pas tout, je comprends un peu plus.
« On ne peut pas aider tout le monde.», « On ne peut pas tous les accueillir. », « On ne peut rien faire, ça doit être une décision politique ». Et on ne fait rien, parce que tout seul on ne peut rien, de toute façon, on ne sait pas comment faire, et personne ne va nous l’apprendre.
Quel défaitisme ! Quelle triste vie que celle-ci! Ha ! C’est sûr que rester enfermé chez soi en regrettant de ne pas savoir ce qui se passe au-dehors, ça va pas aider !
Je ne sais pas tout. Je ne dirige aucun pays, n’ai à moi seule aucun pouvoir au niveau géopolitique. Je ne suis rien face à ce conflit qui broie les humains comme un géant changerait les pierres en sable.
Mais je ne peux pas me résoudre à ne rien faire. Si je peux faire une toute petite, rien qu’une toute petite chose à mon niveau à moi, celui d’une petite gymnasienne… Si je peux accomplir ce minuscule exploit…
Je ne peux rien faire, là, je ne suis qu’une entité étrange qui flotte dans l’air de la nuit au-dessus de la Méditerranée.
Sauf que j’ai un corps qui m’attend chez moi. Et en fait, il est plus un outil qu’une prison. Je peux m’en servir de ce corps, pour accomplir ce tout petit exploit. Retourner chercher le bocal en verre et reprendre mon identité.
Écrire. Écrire ce que j’ai vu, leurs pensées et leurs espoirs.
Je veux, même à mon tout petit niveau, agir pour ceux qui ont besoin d’aide.
Écrire, agiter les pensées de ceux qui doutent, réveiller les convictions au fond du cœur des gens.
Je ne pourrai pas, d’un livret d’à peine une vingtaine de pages, changer la face du monde, arrêter la guerre en Syrie, faire cesser le terrorisme ou convaincre tout le monde de s’aimer dans la joie et l’insouciance.
Écrire, communiquer ce que je ressens. Partager. Et peut-être que quelqu’un qui lira ce texte y trouvera un peu d’écho à ses propres espoirs.
Alors nous serons deux à vouloir mettre notre grain de sel dans cette machine bien huilée qu’est le cercle vicieux de la vengeance. « C’pas moi qu’a commencé ! »
Si nous sommes deux, nous pouvons parler à nos amis, aux passants et aux inconnus. Qui sait, nous pourrions en convaincre un.
Alors nous serons trois. Quatre. Cinq. Six. Dix. Vingt. Trente. Cinquante. Cent, mille, cent mille !
Cent mille grains de sel dans une machine, chacun à ronger une pièce…
On va bien finir par l’empêcher de tourner rond, non ? Rien qu’un tout petit peu, juste histoire de nous convaincre que l’on n’est pas totalement impuissants.
Et au pire, si tout rate, on aura pu dire que l’on a essayé. Et on recommencera.
Je crois sincèrement qu’il y a dans l’être humain quelque chose de bon. Et qu’il suffit de s’attarder un moment pour le découvrir, en abordant un esprit comme un labyrinthe qui cacherait un trésor. Même si la vie y a ajouté des circonvolutions et que des peurs monstrueuses y rôdent, à force de chercher, on finira bien par tomber dessus, non ?
Et si on arrêtait de fermer les yeux sur ceux qui s’échouent sur les plages ? Et si on arrêtait d’avoir peur de cet inconnu qui vient chercher refuge ? Et si on arrêtait de croire que la distance peut estomper la réalité de la mort ? Et si on arrêtait de nier que le désespoir et la méconnaissance sont le terreau de l’extrémisme ?
Et si on cherchait à chaque fois un peu de nous en l’autre ?
On ne vivrait pas plus mal, non ? On ciblerait les causes, au lieu de râler pour les conséquences, et on pourrait faire quelque chose, non ?
Mais bon ! Après tout, ce que je dis n’a aucune importance. Je ne suis qu’une gymnasienne normale et banale, qui ne connaît rien des réalités de la politique et de la guerre, et qui a encore la tête pleine de rêves naïfs comme ceux des enfants. C’est pas comme si je pouvais faire quoi que ce soit qui changerait les choses.
Non ?
Dommages collatéraux ou le curieux voyage d'un ectoplasme #5
- Le 03/03/2016
- Commentaires (0)
Bienvenue en Syrie...
_____________________________
Combien de temps a passé ? Ai-je dormi longtemps ? Je suis réveillée par des mots et des idées qui tourbillonnent. Je suis assise par terre, sur une pelouse éparse. Je suis en colère, à chaque fois que l’on me demande pourquoi je suis venue, pourquoi ma famille a quitté sa maison, sa ville et son pays, à chaque fois que l’on décrit ma vie actuelle aux informations du soir, que l’on s’étonne que je parle l’anglais presque parfaitement, que l’on me dit de rentrer chez moi, car bien entendu, si je possède et sais me servir d’un téléphone portable, c’est que mon pays est sans danger, à chaque fois que l’on me prend pour une imbécile inculte parce que je voile mes cheveux, à chaque fois, j’ai mal. Je sens cette révolte qui gronde dans ma poitrine. Ces gens savent-ils seulement ce que j’ai vécu, et pourquoi j’ai décidé de mon plein gré de renoncer à la terre de mes ancêtres et à me jeter sur les routes avec un mari et une fillette de huit ans ? Non, ils ne savent rien, ils sont bien au chaud dans leur villa ou leur appartement alors que nous nous demandons si nous pourrions manger ce soir-là, et si la police ne nous expulsera pas du parc où nous avons tendu quelques toiles de tentes afin d’y passer la nuit.
Mais malgré tout, je tente de rester souriante, aussi souriante que si nous vivions encore dans notre coquette maison. Qui ne ressemble sans doute aujourd’hui plus qu’à une ruine ou une bâtisse hantée. J’ai vu les villes syriennes, je les ai traversées. Il n’y a que des ruines, et des morceaux de métal qui dépassent du béton, comme les côtes d’un animal géant pourrissant au milieu des gravats.
Je tente de sourire et de rester en vie, de maintenir un espoir, car un jour, bientôt je l’espère, la guerre sera terminée, et nous pourrons rentrer chez nous. Nous engagerons un bon architecte, et nous reconstruirons une maison encore plus belle. On peindra les murs en orange ou en rose, et nous auront un joli jardin avec des rosiers, des tournesols et de jolis arbres qui nous procureront de l’ombre l’été venu. Un pêcher serait parfait. Tandis que je lirai tranquillement couchée dans l’herbe, Layla grimpera dans l’arbre et s’y empiffrera de fruits juteux et sucrés. Tarek, lui, sera sans doute en train de bricoler une cabane ou des jouets de bois pour notre fille, car il est très habile de ses mains.
Nous rebâtirons l’école, et je retournerai enseigner là-bas les mille et une merveilles de la connaissance à des enfants qui, eux, n’auront connu que la paix. Mon mari, lui, reprendra son travail de sculpteur et redécorera entièrement les lieux.
La boîte aux lettres annoncera fièrement « Tarek, Maysan et Layla al-Shaari »
Je sens que l’on me tire la manche.
- Maman ! Maman !
C’est Layla, ma fille. Elle porte un pullover rose et un pantalon de toile solide, tous deux passablement usés, avec une écharpe bleue autour du cou.
- Maman, est-ce que ça va ? Pourquoi tu pleures ? Quelqu’un a été méchant avec toi ? Tu veux que j’aille chercher papa pour qu’il lui casse la figure avec son machin pour sculpter ?
Elle mime un coup de poing et frappe de ses pieds contre un arbre innocent en lançant des « Yaaa ! » et des « Paf ! » à tort et à travers, sa natte virevoltant dans tous les sens.
Je m’essuie le visage de la manche, en effet une larme a coulé sur ma joue et imprègne maintenant le tissu.
- On appelle ça un burin, et non ma chérie, personne n’a été méchant avec moi, c’est juste que j’avais une poussière dans l’œil…
- C’est ce que disent les gens qui ne veulent pas que l’on sache qu’ils pleurent, ça !
Ces quelques mois de voyage ont fait grandir ma fille plus vite que prévu. Elle a à peine huit ans et déjà, elle agit parfois comme une adulte et fait preuve d’une faculté d’adaptation impressionnante. Certes, lorsque nous avons quitté la maison, elle a pleuré, elle s’est accrochée au portail en pleurant et nous n’avons réussi à la décrocher qu’en lui promettant que nous reviendrions, que cette fuite que nous entreprenions n’était que de grandes vacances et que nous allions voyager pour voir d’autres pays, loin à l’ouest. Nous lui avons dit qu’elle reverrait ses cousins, qui étaient partis trois ans auparavant, mais elle ne se souvenait pas d’eux.
Je reprends la lessive que j’avais commencée quelques minutes plus tôt. C’est bizarre, il y a quelques mois, je n’aurais jamais imaginé faire ma lessive dans un baquet de plastique, assise dans un parc et la faire sécher sur une corde tendue entre deux arbres déplumés.
Il doit être à peu près six heures du soir, et nous sommes fin septembre. J’espère que nous trouverons un endroit mieux isolé qu’une tente pour passer l’hiver. Notre objectif est pour l’instant d’atteindre l’Allemagne, où la famille du frère de Tarek s’est réfugiée.
Nous n’avions pas voulu partir au début de la guerre, car j’avais insisté pour enseigner aussi longtemps que possible dans l’école du quartier. Lorsque les hommes de Daech sont arrivés, la première chose qu’ils ont faite, c’était d’interdire aux femmes d’enseigner. J’ai dû quitter l’école, puis Layla a aussi été empêchée de se rendre en cours. Seul mon fils, Nassim, le frère jumeau de Layla, a pu continuer à étudier. Lorsqu’il revenait à la maison le soir, il nous racontait que les nouveaux professeurs leur apprenaient à utiliser des armes et leur inculquaient ce qu’ils appelaient « la bonne morale musulmane » qui consistait à répandre la parole d’un dieu que je ne reconnaissais pas à travers le pays et le monde à coup de mitraillettes. Ils avaient étrangement fait de l’école leur quartier général.
Les barbus ne sont pas restés longtemps dans l’école. Un jour, elle a simplement disparu. Explosé. Elle s’est volatilisée et à la place, il n’y avait plus qu’un champ de ruines. Et sous les ruines, on a retrouvé le petit corps désarticulé de Nassim.
Je m’en suis voulu de l’avoir laissé aller à l’école ce jour-là, de ne pas avoir été capable de le protéger, mon seul fils était mort. Mort par la faute de tous ceux qui pensent imposer leur loi par les armes, que ce soit celle de Dieu ou une autre. Ce sont toujours les enfants qui sont les premières victimes des guerres, les seconds étant ceux qui les aimaient.
J’ai passé les jours suivants dans une sorte de flou, je ne mangeais plus et ne sortait plus de la maison, ce qui m’était de toutes façon interdit si je ne le faisais pas en compagnie de Tarek et sous la burqa. C’est lui qui s’est occupé d’organiser l’enterrement conformément à la tradition.
Layla, elle, a encaissé la nouvelle et s’est contentée de récupérer l’écharpe de son frère qu’elle n’a plus quittée.
Le jeudi, Tarek et moi nous sommes longuement concertés sur ce qu’il convenait de faire. Il nous paraissait inconcevable de continuer à vivre dans cette ville presque en ruine, sans éducation pour notre fille et sans aucune liberté de mouvement.
Nous avons donc décidé de fuir.
Il ne fallait emporter que le strict minimum, car nous risquions de devoir porter nos sacs sur de longues distances. Pas d’objets de valeur nous plus, ils risquaient trop d’être dérobés par des gens plus désespérés que nous.
Un sac à dos chacun, quelques habits solides, nos téléphones portables, une casserole, un couteau pliable, du savon, du matériel de premier secours, un peu d’argent ainsi que nos papiers d’identité. C’était tout ce que nous emportions en exil. Nous avons réparti la charge dans trois sacs à dos et avons enfilé de bonnes chaussures.
Nous avions prévu d’utiliser la voiture familiale le plus longtemps possible, du moins tant que nous n’aurions pas à refaire le plein. Les stations-service étant strictement réglementées par les envahisseurs, nous avons dû emplir le réservoir avec le jerrican de secours qui se trouvait dans le coffre. Nous savions ne pas pouvoir aller très loin avec ce plein sommaire, mais espérions pouvoir prendre un bus dans la ville suivante.
Nous sommes donc partis avant l’aube, à cette heure de la nuit où tout est si silencieux que le battement de nos cœurs paraissait plus bruyant qu’une armada de tambours. Nous avons fourré les sacs dans le coffre et sommes partis, laissant derrière nous notre ancienne vie.
Nous avons roulé, roulé. Nous sommes sortis de la ville. Roulé. Le soleil s’est levé, Layla s’était rendormie depuis un bon moment déjà. Roulé. Sur les routes de plus en plus petites, de moins en moins bien entretenues. Roulé. Nous n’avons croisé que peu de véhicules, et par chance, aucun camion paramilitaire n’a eu l’idée de nous arrêter. Alors que l’on n’était qu’au milieu de la matinée, la voiture a ralenti et s’est arrêtée. Le réservoir était vide et notre objectif encore loin. Nous allions devoir continuer à pied.
Nous avons marché des heures sous le soleil de plomb qui semblait vouloir nous assommer. Tarek et moi portions Layla à tour de rôle car elle se fatiguait très vite. Nous avons marché le reste de la journée, profitant parfois d’un bosquet ou même d’un arbre isolé pour faire une pause à l’ombre. Le soir venu, nous n’étions plus très loin de la ville mais avons décidé de dormir à l’abri d’un mur de pierre sèche non loin de la route.
Le lendemain matin, nous avons encore marché une heure avant de trouver un arrêt de bus. Assis sur une pierre, nous avons patienté un moment avant de voir arriver une boîte de conserve sur six roues, autrefois peinte en jaune et bondée de travailleurs qui se rendaient en ville. Le véhicule s’est arrêté en grinçant devant nous, et nous voilà partis pour notre prochaine étape.
Après cette ville, ça a été une autre, puis encore une. Nous avons traversé la frontière turque à l’est d’Aïn al-Arab et avons trouvé refuge dans un des camps disséminés dans la région. Là, on nous a donné à boire et à manger, ainsi qu’une place dans une tente surpeuplée. Un psychologue a pris en charge notre fille, c’était un Suédois membre d’une organisation humanitaire. Son véritable nom étant totalement imprononçable, il se faisait appeler Tom, ce qui arrangeait bien tout le monde. Il était grand, maigre et osseux, avec des mains sèches et fines. Ses cheveux étaient d’un blond sale, car au camp, on n’avait pas souvent l’occasion d’utiliser un shampoing. Ses yeux étaient d’un bleu terne et sa peau sans doute auparavant très pâle avait pris une teinte presque normale sous le soleil d’été. Tom était sans doute un bon psychologue, car alors que Layla était demeurée silencieuse et renfermée pendant la majorité du voyage, elle avait récupéré sa joie de vivre et son énergie. Elle pouvait passer des heures à courir entre les tentes, à jouer au ballon avec d’autres enfants et à tenter d’esquisser des cartes du monde dans la poussière.
Nous avons passé un mois entier au camp, l’hiver nous surprendrait trop vite si nous y restions plus longtemps. Nous avons profité d’un car qui se rendait à Ankara depuis le plus proche village pour reprendre la route.
Un train de Ankara à Istambul. Frontière Bulgare à pied, sous les barbelés et les caméras des reporters. Puis un bus vers la Roumanie, à pied quatre jours vers l’ouest. Ensuite, nous avons embarqué dans un train plein comme un œuf pour la Hongrie. À Budapest, nous sommes montés dans un autre qui nous emmènerait vers l’Allemagne. Il n’a jamais démarré et on nous a sommés d’en sortir et de nous rendre dans un camp prévu pour les gens comme nous. Nous avons refusé et avons campé dans la gare. Cela faisait un mois, deux semaines et cinq jours que nous étions partis du camp turc. Lorsque l’on nous a chassés de la gare, nous avons élu domicile dans un grand parc alors transformé en gigantesque camping en patchwork.
Fin septembre. C’était déjà fin septembre. L’hiver n’est plus très loin, et si les journées sont encore agréables, on commence à frissonner la nuit.
Non loin de moi, Tarek fait bouillir une marmite de thé odorant alors que Layla enfile son blouson offert par une association caritative qui passait par là. Il est vrai que le soir venant, la chaleur se dissipe vite. Elle s’assoit aux côtés de son père qui la serre contre lui.
Je me lève et étire mes jambes et mon dos ankylosés par la position demi-assise, demi-accroupie que j’avais adoptée pour faire ma lessive. Une fois celle-ci étendue, je les rejoins autour du réchaud à gaz pour boire une tasse de thé avec laquelle je me brûle la langue.
Les nuages sont roses sous la lueur faiblissante du soleil, ils ressemblent à un troupeau de barbes à papa géantes. Je souris devant cette image idiote.
Une légère brise se lève et fait frémir l’écharpe bleue autour du cou de Layla qui sirote doucement son thé.
Je m’élève en même temps que la vapeur du thé. Cette famille ne pourra peut-être pas s’établir en Allemagne ou ailleurs en Europe, mais au moins, ici, elle est en relative sécurité. Pas de bombes ou de chars d’assaut.
Reste le froid et l’errance, la souffrance d’être loin de son pays et d’avoir tout perdu.
________________________
Dommages collatéraux ou le curieux voyage d'un ectoplasme #4
- Le 22/02/2016
- Commentaires (0)
- Dans Historiettes
Quatrième partie! On part pour les USA...
_____________________________________
Je décide de suivre la machine un bout de chemin. D’abord, elle tourne un peu en rond, au-dessus de la ville, puis elle repart vers l’ouest. Elle patrouille longtemps dans des régions désertiques, puis survole un moment une ville plutôt importante. Un peu plus tard, elle vire au sud et se pose dans un aérodrome militaire. Si je veux trouver le pilote, il va falloir que je passe par les communications du drone. Ça ne va pas être amusant. Je dois passer par les ondes satellite et des kilomètres de câbles. Pas génial du point de vue du paysage. Mais si c’est ce qu’il faut faire…
Je suis donc les ondes et les câbles. Je parcours des milliers de kilomètres en dix secondes et arrive dans un conteneur glacé. Là, il y a quatre hommes. Je viens d’arriver par le casque audio de l’un d’eux. La porte s’ouvre, laissant entrer une paire d’hommes qui remplacent l’équipe que j’ai suivie. Quelques minutes plus tard, un troisième homme arrive et s’installe sur un siège en racontant des histoires absurdes. L’autre équipe l’écoute en souriant. Il a l’air d’attendre quelqu’un.
Ce quelqu’un fait irruption au milieu de la conversation. Chevelure foncée, yeux clairs et l’air d’un trentenaire tout ce qu’il y a de plus banal. Un Américain moyen qui arrive au travail, simplement qu’il enfile une veste militaire en entrant dans le conteneur.
Il va partir en mission, là, normalement, non ? J’ai bien envie de voir à qui ça ressemble… À quoi pense un pilote quand il pilote ? Et moi, pourquoi je me pose cette question alors que je peux avoir la réponse tout de suite ? J’attends qu’il inspire, et comme précédemment, je rentre dans son nez et vais me loger dans son cerveau. Les odeurs, les couleurs et les sons changent, un flot de pensées chasse les miennes, ou plutôt devient les miennes.
Quelle idée de mettre la climatisation aussi bas… Il fait 30° à l’ombre, ici, au Nouveau-Mexique. Nous sommes au milieu du mois de juin, il est sept heures du soir et je vais commencer mon service de nuit. J’ai embrassé ma compagne qui revenait du travail alors que je venais de me réveiller, j’ai coiffé mes cheveux noirs, brossé mes dents pendant deux minutes trente et ai enfilé mon uniforme. En quittant notre petite maison de Santa Fe, j’ai longé le terrain de golf et ai emprunté la Paseo Real qui sort de la ville par l’ouest. Après une heure de trajet, en parcourant des routes de plus en plus petites et poussiéreuses, je suis arrivé à la première barrière. Il y a trois enceintes de grillages électrifié, surmontés de barbelés. Chaque fois, je stoppe ma voiture devant la barrière, montre ma carte et décline mon identité pour pouvoir continuer.
Après cette cascade de contrôles, je suis parvenu à atteindre la base, comprenez un bâtiment de béton brunâtre bas. J’ai garé ma voiture, une jeep tout ce qu’il y a de plus banal, entre une camionnette militaire et une moto au pare-boue aussi ocre que le sol sablonneux qui tente de se faire passer pour de la terre dans ce pays. Je suis descendu de mon véhicule et me suis dirigé vers la bâtisse tout en finissant un gobelet de café tiède. J’ai bipé mon badge et les portes vitrées se ouvertes sont en chuintant. Une bouffée d’air climatisé m’a fait frissonner alors que je marchais vers le panier de viennoiseries trônant sur le bureau de l’accueil, passant sous le modèle réduit d’un MQ-1 Predator suspendu au plafond. C’est ce type de drone que nous pilotons, le drone de l’armée américaine, un vrai petit bijou de technologie. J’ai annoncé ma présence à la secrétaire au regard sévère cachée derrière les viennoiseries puis ai traversé le bâtiment par un long couloir en moquette verdâtre. Je suis ressorti de l’autre côté par une petite porte en verre, elle aussi. De nouveau, l’air était sec et brûlant. Là, jouxtant le bloc de béton brun, sont placés deux containers, un bleu et l’autre rouge. J’ai bipé à nouveau mon badge à l’entrée du rouge, le plus proche de la porte et suis entré dans la pièce aménagée à l’intérieur. J’ai soupiré de soulagement en sentant à nouveau la climatisation, même si elle est vraiment trop froide, cela vaut toujours mieux que la fournaise de dehors.
Je remets ma veste, il fait quand même trop froid. Sur celle-ci brille un insigne de l’armée américaine qui annonce fièrement « US Air Force, Timothy White».
Dans le container, Les murs sont couverts d’écrans et moniteurs en tous genres, de la caméra infrarouge au radar, en passant par les images satellites d’un désert lointain. Devant les écrans, des sièges qui ressemblent à ceux d’un cockpit d’avion. C’est d’ailleurs le nom que l’on donne, non sans ironie, à notre container. Le cockpit… Sauf que c’est un cockpit qui reste cloué au sol désertique du Nouveau-Mexique. Dans chaque siège, il y a un type comme moi, les mains crispées sur un clavier et les yeux rivés sur ses écrans, des écouteurs vissés sur les oreilles et un micro à quelques centimètres de leurs lèvres. On est quatre dans la pièce, je comprends que je suis un peu en retard car mes collègues de l’équipe de nuit sont déjà là. L’un des hommes, un gringalet aux yeux cernés, enlève son casque et s’étire, il m’a vu arriver et c’est lui que je dois remplacer.
- Salut Dave, ‘passé une bonne journée ?, lui lancé-je.
- Mouais, si on oublie que le clavier déconne et que j’ai pas eu l’autorisation de Môssieur le chef d’aller en chercher un autre à la réserve sous prétexte qu’on était en pleine mission ! T’y crois, toi ? »
Je souris, il me libère sa place et je m’enfonce dans le fauteuil. Un courant d’air chaud passe lorsqu’il sort du container. Je pose les écouteurs sur mes oreilles et le ronronnement incessant des ordinateurs et de la climatisation s’assourdit pour faire place à la conversation de l’équipe. « …et là, y’a les chèvres qui commencent à courir dans tous les sens et puis le berger qui essaie de les rattraper ! C’était tellement…
- Désolé du retard les gars, j’espère que je ne vous dérange pas, ton histoire avait l’air tellement intéressante, mon cher Pat.
- Ah ! Te voilà enfin ! On s’occupait juste pour éviter de se fossiliser en t’attendant…
- J’ai dit que j’étais désolé…
Patrick Jones, alias Pat, c’est mon coéquipier. Il faut deux personnes pour piloter les Predators, l’un s’occupe du pilotage à proprement parler et de la caméra et l’autre du largage des missiles. Pat est pilote, je suis tireur. Je vise, et j’appuie sur le bouton.
Les deux autres, c’est Isaac Hill et Harold Lawrence, ils composent la deuxième équipe présente dans ce container. Nos deux drones se trouvent actuellement dans une base quelque part dans l’ouest de la Syrie. Des hommes sur place ont fait le plein d’essence, ont vérifié les moteurs et nettoyé les objectifs des caméras. Les drones sont prêts à décoller. Pat se concentre sur son écran et dirige l’engin de huit mètres de long sur la piste de décollage. Il fait pivoter la caméra en attendant le signal qui nous permettra de nous envoler. Il fait encore sombre, en Syrie. Il est cinq heures du matin, météo presque parfaite, à peine un petit vent d’ouest. Le signal du départ est enfin donné. L’engin roule de plus en plus vite sur la piste puis s’éloigne du sol. Nous partons vers l’est alors qu’Isaac et Harold pilotent vers le nord et la frontière turque.
Nous sommes partis pour une journée de mission.
Je préfère l’équipe de nuit, parce que l’on n’a pas besoin d’utiliser la caméra infrarouge vu qu’il fait jour en Syrie à ce moment-là. On voit les couleurs du paysage, bien plus vert que celui de l’Afghanistan, même si dans environ une heure, nous survoleront à nouveau une région désertique. Notre objectif se trouve dans une ville du centre du pays, on nous a ordonné d’éliminer un chef de groupe terroriste qui s’y cachait, et que nous avons débusqué à force d’observation. Il faut dire que cela fait bientôt trois semaines que nous survolons la région, l’équipe de jour et nous, filmant et notant les allées et venues de voitures transportant des canons anti-chars ou des combattants.
Aujourd’hui, c’est la concrétisation de tout ce boulot d’espion, nous allons tirer les missiles et éliminer notre cible.
Après un moment, une autre heure, le paysage change, devient sec. Plus nous nous approchons de notre but, plus la tension est palpable dans le cockpit. Je jette un instant un œil sur l’écran d’Isaac. Il survole une zone urbaine. Pat m’interpelle, « On arrive…». Les bâtiments paraissent devenir plus haut, les routes plus larges. Je reconnais le groupe de bâtiment que nous devons viser. Je connais sa forme par cœur à force de le voir sur l’écran. Pat le survole, le dépasse avant de revenir en faisant une forme de 8 au-dessus. Le soleil s’est levé et la ville s’éveille, on commence à voir des voitures dans les rues.
Nous descendons de plus en plus, afin de préciser le tir. Soudain, ça y est, je peux pointer le viseur laser sur l’objectif. J’appuie sur le bouton. Quatre secondes de latence le temps que l’information arrive au drone.
Et là, je vois quelques petites silhouettes qui entrent dans le bâtiment. Des silhouettes hautes comme un enfant. Je tente d’annuler le tir, ou au pire de le détourner.
Rien ne se passe, ça ne fonctionne pas. Non ! Le clavier cassé ! J’ai oublié de le changer ! Je m’acharne sur la touche en espérant retarder le tir mais il est trop tard, je ne peux plus détourner les missiles qui filent vers la bâtisse. Quelques trop longues secondes plus tard, il y a une grande lumière qui aveugle la caméra, l’explosion. Les murs s’écroulent, partent en poussière. Plus de traces des gamins.
- C’était des gosses ? Me demande Pat, la voix tremblante
- Ouais, je crois que c’était des gosses…
- C’était un chien.
La dernière voix, je ne la connais pas, elle appartient sans doute à un de ceux qui ont ordonné la mission et qui suivait bien tranquillement le déroulement des opérations depuis son bureau, peut-être au Pentagone.
Un chien ?
Une troupe de chiens sur deux pattes ?
Vraiment ?
- Fin de la mission, beau boulot les gars, reprend la voix.
Beau boulot ? On a tué des gosses. On devait éliminer un chef terroriste et on a tué des gosses. Je suis comme figé, crispé sur mon clavier, les yeux rivés sur l’écran, la ruine qui fume et les fourmis qui s’agitent autour, qui fouillent dans les pierres.
- On rentre, lâche Pat
- …
-Tiens, après je t’emmène boire un verre au Palace, ou deux… ou trois. On y a bien droit, non ?
Il fait remonter le drone et nous prenons le chemin inverse de celui qui nous a amenés dans cette ville perdue au milieu de la Syrie. De nouveau, une heure de vol au-dessus du désert, puis les régions vertes, et enfin, la base. Nous n’avons plus prononcé un mot du trajet.
Le drone posé à la base aérienne, nous avons déconnecté nos écrans. J’ai jeté un coup d’œil sur celui d’Isaac. Ils surveillaient la frontière turque je crois.
Je suis rentré chez moi. Pas envie de boire, même avec Pat. Il est cinq heures trente lorsque j’arrive à la maison. Je veux dormir, je m’allonge sur le canapé.
Impossible de fermer les yeux, les images de la caméra tournent dans ma tête. J’entends des bruits d’explosions, j’ai presque l’impression de sentir l’odeur de la fumée.
Était-ce véritablement nécessaire d’intervenir cette fois ?
Oui, un chef de guerre, il faut l’éliminer… Mais les gosses ? Et ils faisaient quoi, là ? C’était une école ou quoi ? Ça voudrait dire qu’il y en avait d’autres à l’intérieur ?
Je suis un meurtrier. Un tueur d’enfants.
On l’impression qu’on joue à un jeu vidéo quand on pilote ces machines. Mais les personnages sur l’écran sont bel et bien réels. Ça, j’étais supposé le savoir, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je l’ai compris. On fait une guerre « propre », on ne risque rien à piloter nos drones. On ne se met pas en péril. Nous sommes précis, efficaces.
Frappe chirurgicale. C’est un terme qui plaît beaucoup. On est des chirurgiens, pas des soldats. Ça vient de l’idée que nous sommes là pour enlever une tumeur et que nous sommes donc forcément les gentils de l’histoire.
La fatigue finit tout de même par me rattraper, et je plonge dans un sommeil agité.
Je vole au-dessus d’une ville. L’air est bon, le vent frais et agréable. D’un coup, je commence à chuter, de plus en plus vite. Il y a une traînée de lumière derrière moi. Je m’écrase sur le toit d’un bâtiment et tout explose dans un silence tonitruant. Le décor change. Je suis dans une salle de classe. Des enfants sont penchés sur leurs tables. L’un d’eux lève la tête vers moi. Il n’a plus de visage, juste une sorte de matière brûlée et incrustée de gravats. Je sens une odeur écœurante. Je ne peux pas détacher mon regard de ce visage détruit. Je tente de fuir, reste figé. L’enfant se lève, tend sa main écorchée vers moi et…
Je me réveille en criant, transpirant et les larmes aux yeux. Je me recroqueville dans un coin du sofa en tremblant.
Une partie de moi est partie avec le missile. Je ne pourrais pas retourner dans le conteneur, je ne m’en sens pas capable.
Demain, je poserai ma lettre de démission.
Et moi, je suis où ? Quand il a commencé son rêve, j’étais bel et bien dans son esprit, mais j’en ai été comme éjectée lorsqu’il s’est réveillé.
Il fait presque complètement noir. J’ai un poids énorme sur le corps et je ne peux pas bouger. J’entends des bruits de pas au-dessus de moi. Ils sonnent comme si l’on marchait dans des gravats. Un rayon de soleil filtre soudain entre deux pierres que l’on soulève, je profite de l’interstice pour me glisser hors de cet espace exigu.
Je suis dans les ruines d’un bâtiment. Ainsi, il est donc possible de voyager par un rêve ? Je le reconnais, c’est celui sur lequel est tombé le missile. Il y a des groupes d’hommes qui déplacent des pierres à la recherche de corps ou de survivant. Ils viennent de trouver un petit garçon avec une écharpe bleue autour du cou. Il ne bouge plus du tout et ses membres sont tordus s’une façon qui ne me paraît pas naturelle.
Je les suis. Un homme au visage fermé, silencieux porte le garçonnet dans une maison.
Je suis fatiguée. Je pense faire un petit somme avant de continuer mon voyage. Je m’introduit dans l’esprit d’une femme qui pleure et m’endors.
______________________________________
Dommages collatéraux ou le curieux voyage d'un ectoplasme #3
- Le 13/02/2016
- Commentaires (0)
- Dans Historiettes
Pour vous, la troisième partie. Une journaliste, une explosion et des drapeaux...
_________________________________
Plongée dans mes pensées, je n’ai pas remarqué que l’agitation au sol avait changé. Maintenant, il y a des ambulanciers qui se pressent moyennement pour embarquer le corps recroquevillé sur le béton, et de plus en plus de monde, une foule qui vient assouvir sa curiosité. Ils ont l’air de penser « Ho ! Enfin quelque chose d’intéressant qui se passe ! ».Alors… que voit-on d’intéressant par ici ? Je ne veux pas rester plantée là pour l’éternité ! Il me faut changer d’air…Des policiers ? Non, j’ai bien envie de voyager, sans doute vers l’est. Qui parmi cette masse de gens pourrait me servir de véhicule ? Un de ces curieux qui prend des photos du cadavre avec son téléphone. Non, je n’ai absolument pas envie de me retrouver dans la tête d’une personne aussi morbide. Un journaliste alors ? Alors, là, il y a plus de chances de trouver un sujet intéressant. Hmm… Quel choix ! Il y a beaucoup trop de journalistes maintenant autour du cordon de police. Peut-être celle-ci ? Oui, elle m’a l’air pas mal. Assez jeune, les cheveux auburn, les yeux bruns et attentifs, plutôt fine. Elle est habillée d’un pantalon droit simple, noir, et d’une chemise à manches courtes bleue. Allons donc voir ce qu’elle peut nous raconter.
Se positionner devant son visage, et lorsqu’elle inspire, entrer dans ses poumons, traverser les alvéoles, passer dans le sang, faire un tour de toboggan dans le cœur et arriver au cerveau. Là, les pensées m’assaillent. Ah, bien, je suis en train de penser à la synagogue, je vais juste suivre ce fil-là. C’était horrible. C’était un vrai carnage, des cadavres partout. Et du sang et des impacts de balles. Comment pouvait-on oser commettre pareille monstruosité en plein centre de Paris ? Le journal m’avait envoyée là pour couvrir l’affaire, mais je ne savais pas par où commencer. J’ai interrogé un ou deux policiers, qui ne me répondaient que par monosyllabes et m’ordonnaient de dégager la place, qu’ils avaient du travail et n’avaient pas besoins de ces gêneurs de journalistes dans leurs pattes, surtout qu’ils avaient tendance à plus donner d’informations à ceux qu’ils voulaient arrêter qu’à la population, ces incapables ! Bref, je n’étais pas vraiment la bienvenue auprès de nos chers responsables de l’ordre public. J’ai donc décidé de suivre les rumeurs et la radio pour rejoindre la zone de la poursuite. Ça, c’était plutôt facile, il suffisait de suivre les routes dégagées. Ma voiture est plutôt rapide, donc j’ai eu tôt fait de rejoindre le lieu où la Peugeot noire avait été vue pour la dernière fois. Là, de nouveau, il y avait beaucoup de policiers qui surveillaient la route, qui contrôlaient papiers d’identité et permis de conduire. J’ai dû montrer au moins dix fois ma carte ! C’est ce qu’ils appellent « boucler la zone », on l’entend à la radio. Je devais apporter un semblant d’article pour l’édition du soir, et on était déjà en milieu d’après-midi. Quel boulot de masochiste…
Quand je suis arrivée devant la librairie, il y avait déjà foule. Journalistes, curieux, policiers, une vraie foire aux informations.
Soudain, j’ai vu quelque chose bouger derrière la vitrine. Ça s’approchait de la porte. Là, les assiégés sont sortis. Ils avaient un otage, un pauvre type qui pleurait toutes les larmes de son corps. La foule a eu un mouvement de recul en voyant leurs armes. Pas mal de gens sont partis en courant, mais je suis restée. Quand l’un d’eux a lancé une grenade, puis une bombe, je me suis abritée derrière une voiture de police. J'ai senti le souffle de l’explosion sur mon visage et mes bras, brûlant.
La police a tiré. Ils ont abattu un des deux terroristes et ont arrêté l’autre. Quant à moi, j’avais noté le moindre évènement dans mon carnet, et j’étais prête à écrire mon article. Le reste des informations viendrait par des communiqués de la police. Je suis retournée à la rédaction et j’ai mis en forme mes infos, en tentant de garder le plus grand calme à chaque fois que le rédacteur-en-chef venait me demander si j’avais terminé. Ce qui se produisait… environ toutes les quatre minutes, ne soyons pas trop sévères. Je suis tout de même parvenue à achever mon papier, que j’ai livré au rédac’chef qui salivait d’impatience. C’est sûr, dès qu’un événement important arrivait, il était aussi impatient qu’un enfant à l’idée de voir les ventes de sa feuille de chou exploser.
Mon article n’était pas du grand art, mais en effet, les ventes ont explosé dès la sortie de presse du journal.
Quelques semaines plus tard, alors que l’affaire de l’attentat commençait à retomber, le rédacteur-en-chef m’a convoquée pour me parler de son nouveau projet pour augmenter les ventes. Il m’a reçue dans son bureau, qui, soit dit en passant, n’est pas bien grand, et m’a demandé, voire même ordonné de partir faire un reportage en Turquie, sur la piste des réfugiés et des djihadistes. Pour une fois qu’il proposait un sujet intéressant, je ne pouvais pas refuser.
C’est ainsi que le lundi d’après, je me suis retrouvée dans l’avion, direction Ankara. Arrivée là-bas, j’ai loué une voiture pour pouvoir me déplacer plus librement. Mon but était de rejoindre la frontière syrienne, et si la zone n’était pas trop dangereuse, de passer quelques temps en Syrie. Je devrais être prudente, les prises d’otages ne sont pas rares dans la région.
Je devais rejoindre près de Kobané un guide et interprète que m’avait recommandé Mikhaïl, un ami de longue date passionné de culture moyenne-orientale, et qui passait le plus clair de son temps à essayer des recettes de cuisine de la région, avec plus ou moins de succès.
Cette ville kurde étant à la fois un point de passage pour les réfugiés vers la Turquie et un champ de bataille, c’est l’endroit idéal pour faire des interviews et prendre quelques belles images depuis la colline qui surplombe la ville.
Le guide m’attendait. Il paraissait jeune, peut-être cinq ou dix ans de moins que moi, et son nom était Tarkan. Il avait les cheveux courts et en bataille, les yeux brun clair et une barbe courte un peu clairsemée dont il avait l’air très fier mais qui m’a décroché un petit sourire amusé. On aurait dit, avec sa chemise à carreaux passée par-dessus un t-shirt en coton, qu’il tentait de ressembler à un de ces mannequins que l’on voit dans les publicités pour le parfum ou les sous-vêtements masculins. Le personnage était malgré tout compétent. J’ai pu récolter quelques témoignages intéressants qu’il m’a aidée à traduire. Il s’est de plus montré très au courant des évènements de la ville.
Depuis le sommet de la colline, il me montrait quelle zone avait été tenue par qui et à quel moment. Il a ajouté que c’était pour l’instant les combattants kurdes qui contrôlaient la ville, mais que l’on n’était jamais à l’abri d’un retour des hommes de Daech, qui avaient essuyé ici l’une de leurs premières pertes de terrain.
J’ai pris la décision de rester plusieurs jours dans la région. Je dormais dans la voiture, après avoir couché les sièges et suspendu des couvertures aux fenêtres, cela faisait presque un nid confortable. Mon guide, lui, avait emporté une de ces minuscules tentes de camping qui s’ouvrent lorsque qu’on les lance en l’air, et l’avait directement montée à l’arrière de son pick-up. Nous étions juste derrière la colline.
C’est durant la deuxième nuit, une heure ou deux avant l’aube à peine, que j’ai été réveillée par des bruits d’explosions et de coups de feu, au loin, dans la ville. J’ai rapidement enfilé ma veste et mes chaussures et me suis précipitée sur la butte.
Kobané était presque complètement noire. On voyait quelques lumières s’allumer ici ou là, quelque lampadaires peut-être. Mais on ne peut pas dire que le calme régnait, loin de là. On entendait les combats en bas. Les crépitements de mitraillettes et les explosions montaient jusqu’à mes oreilles, portés par l’air de la nuit.
Au lever du jour, en face, sur une autre colline, un drapeau noir flottait. Et entre ma position et ce drapeau, on entendait encore les combats. Des familles entières étaient montées jusqu’au poste-frontière pour se mettre à l’abri.
Pendant toute la journée, on s’est battu dans les rues. Je pouvais voir des nuages de fumée s’élever là où des explosions avaient eu lieu. Des chars d’assaut passaient parfois devant moi, dans un grand bruit de chenillettes.
Ça a continué le lendemain. Et le jour d’après. La colline en face changeait toutes les demi-journées de propriétaire et de drapeau.
C’est le troisième jour qu’une explosion bien plus grande que les autres a eu lieu.
Il devait être dix-huit heures, et je tentais de suivre les évènements à l’aide de la radio locale et de la traduction de Tarkan. Soudain, on a vu un truc, un objet tomber vers la ville. Ou plutôt voler. Depuis le ciel. C’était pas très grand, mais ça sifflait, et il y avait une traînée lumineuse derrière.
Un missile. C’était un missile tiré depuis les airs. On intervenait depuis le ciel.
Tout est allé très vite. Entre le moment où j’ai vu le missile et l’explosion, à peine quelques secondes se sont écoulées. D’abord, j’ai vu un grand flash de lumière au sud de la ville, là où les hommes de Daech sont rassemblés. Ensuite, le son est arrivé, un boum ! sourd, c’était fort, et j’ai eu l’impression que le sol avait tremblé. Je n’ai même pas eu le temps de filmer l’explosion. De déception, je me suis assise par terre.
J’étais curieuse, qui avait bien pu tirer ce missile ? Un avion Syrien ? Non… Il me semblait que le gouvernement de Damas ne portait pas tant les Kurdes dans son cœur. La Turquie ? Les États-Unis peut-être ? Ce type d’attaque me paraissait être plus leur genre…
Rah ! Tant pis ! Je veux en avoir le cœur sûr, il faut que j’aille voir ! Tant pis pour la journaliste, je veux savoir qui pilote l’engin qui est là-haut. Allez ! Elle se lève en époussetant ses vêtements et pousse un petit soupir agacé. J’en profite pour me glisser hors de son corps. Je veux aller voir ce qui se passe là-haut. Je monte, je monte vers les nuages. En-dessous de moi, je vois une fourmi aux cheveux auburn qui marche vers sa voiture et une ville pleine de fumée, avec des rues à angle droit et des chars dans les rues.
Plus haut.
C’était quand même amusant, cette succession de drapeaux sur la colline. Ça donne un peu l’impression de deux enfants qui se battent pour un jouet en disant « Il est à moi ! ».
Je prends encore un peu plus d’altitude.
Toutes ces fourmis qui s’agitent là-dessous, vu d’ici, ça paraît un peu insignifiant, comme si c’étaient des pions ou des pixels sur un écran.
Ha ! Le voilà ! C’est un drone on dirait… Il est gris clair et ressemble à un planeur de huit mètres de long au museau bombé. Pas de pilote là-dedans, il va falloir faire un bout de chemin dans la carlingue pour le trouver.
_____________
Dommages collatéraux ou le curieux voyage d'un ectoplasme #2
- Le 07/02/2016
- Commentaires (0)
- Dans Historiettes
Voici la partie 2!
/!\ Ce texte raconte l'histoire d'un extrémiste religieux et contient des scènes violentes, notemment une scène d'attentat. Je précise également que ce texte a été écrit à la mi-octobre 2015 et n'est en rien lié aux attentats de Paris le 13 novembre. Merci de ne pas lire si vous être prompt à la sensiblerie.
______________________________________________
Ka-schlank !
Ce bruit. Ce bruit métallique, cette explosion de son clair et profond qui résonne dans la pièce, se heurte aux murs de béton, rebondit, tente de s’échapper entre les barreaux de la fenêtre, remplit mes oreilles de vibrations acier avant de s’évanouir au dehors. Puis les cliquetis-chuchotement des clés alors que la serrure m’enferme dans cette cellule exiguë.
Un concert routinier, tous les soirs, tous les matins, depuis déjà deux mois. Et il en reste encore dix à purger.
Bienvenue au centre pénitentiaire de Fresne. C’est une série de bâtisses en pierre gris sale, parallèles, séparées par des cours de cinquante mètres. On a de la chance, ici, les fenêtres sont encore relativement grandes, si l’on oublie les barres de fer qui les obstruent.
Sur mon badge, c’est écrit « Bastien Carlin, vingt ans, prisonnier numéro 142 » ou un truc dans ces eaux-là. Motif d’inculpation : vol à la tire et insulte à un agent de l’ordre public, avec menaces en prime. Avec ça, on devrait pas avoir autant à tirer, mais vu mon casier, on m’a fait un joli cadeau, en m’offrant quelques mois supplémentaires. Pourtant, je suis pas le plus pourri du coin, j’ai juste la malchance de ne pas courir très vite…
La cellule fait trois mètres par trois, plus une minuscule pièce avec toilettes et lavabo, sans porte. La moitié de l’espace est occupé par deux lits, ils sont séparés par un paravent en papier. On a une table de nuit de chaque côté, qui sert aussi de bureau et bien fixée au sol par quatre grosses vis plates. Contre le mur, en face du lit, il y a une armoire en carton-pâte pour nos habits et nos petites affaires (J’y garde en particulier un vieil ours en peluche élimé que ma mère a cru bon de m’apporter pour me « tenir compagnie » mais que je cache, un peu honteux. Allez donc vous balader dans une prison à vingt ans avec un ours en peluche ! Je n’ai toutefois pas eu le courage de le jeter.)
Cette pièce aux murs jaunes, je le partage avec Yanis. Yanis, il a bientôt trente ans et il est plutôt d’un naturel calme. Il a la peau couleur noisette et ses yeux sont d’un brun presque noir. Il porte ses cheveux foncés très courts et se lime les ongles avec application toutes les semaines. Sinon, il est plutôt fin, pas très grand mais pas trop petit non plus, dans la moyenne je dirais. Il a l’air d’un type plutôt cultivé, puisqu’il passe le plus clair de son temps libre à la bibliothèque. Je me dis qu’il ne doit pas tellement aimer la compagnie puisque la bibliothèque, c’est presque le lieu le plus désert de Fresne. Je pense que le seul lieu plus vide que cette pièce zébrée d’étagères, ça doit être les escaliers de l’aile des handicapés …
Mon coloc’ va prier tous les jours, sauf s’il oublie, trop plongé dans un bouquin, sans doute. Il dit que l’imam n’est pas très au courant des textes du Coran, mais que les temps de prière sont trop importants pour lui pour qu’il les abandonne tout à fait, et aussi que malgré l’imprécision de l’imam, on peut rencontrer des gens intéressants à la prière, et que cela lui permet de moins s’ennuyer.
Un jour, je lui ai demandé ce qu’un type comme lui faisait en prison. Il a répondu : « J’ai fait une erreur, comme toi, comme tous ceux qui sont là. Maintenant je paie ma dette, c’est tout. Évite de poser ce genre de question, la plupart des détenus n’aiment pas trop raconter leur vie. Tout ce que je peux te dire, c’est que j’ai pris pour trois ans.» Je ne lui ai plus jamais redemandé, pas plus qu’à tous les autres.
Comme je le disais, ici, on s’ennuie, on s’ennuie même plus que dans la cité, ou on pouvait au moins fumer une cigarette avec sa bande, assis sur un banc ou sur un mur, en parlant de tout et de rien et en sifflant les filles qui passent. Ici, on a des patchs de nicotine et l’aile des femmes est bien séparée de la nôtre. On nous propose cependant des ateliers de poterie, mais seuls les véritables désespérés y participent.
Un matin où j’avais vraiment rien à faire, ni atelier, ni punition et que j’errais entre les toilettes et la cafétéria, Yanis m’a proposé de l’accompagner prier.
- Peut-être que la religion pourra t’enseigner de bonnes valeurs, qui sait ! Tu pourrais découvrir une autre voie que celle qui t’a amené ici, une lumière qui, quoi que tu fasses, où que tu sois, éclairera ton chemin. Maintenant, à toi de choisir si tu veux suivre cette route vers le paradis ou rester sur celle qui t’aura guidé vers le crime et la prison. Inch’Allah, tu suivras le chemin du bien !
J’ai hésité. Ça me paraissait trop beau pour être vrai. Mais j’avais pas grand-chose à perdre, et Yanis était plutôt sympa, donc j’ai décidé de laisser une chance à la prière, de toute façon, entre ça et la poterie, le choix était vite fait.
Je l’ai suivi un jour. Puis un autre. Encore un. Bientôt, j’y allais quotidiennement, et même lorsque Yanis restait à la bibliothèque, j’étais présent. À chaque fois que l’imam parlait, j’avais l’impression qu’il levait le voile sur quelque chose de grandiose. Toutes les pièces se mettaient en place, je trouvais une réponse à chacune de mes questions, un sens à chaque phénomène, j’avais enfin un but, une bouée à laquelle me raccrocher, tout était logique, évident, c’était la même sensation que lorsque qu’on comprend enfin un difficile problème de maths.
Plus le temps passait, plus je priais. Je priais pour ma cité, pour mes frères et mes sœurs, de cœur et de sang, pour qu’ils trouvent un moyen d’échapper à la pourriture qui les enfermait, qu’eux aussi se rendent compte que ce moyen était la voie que nous offre Allah par l’islam. J’avais envie que le monde entier ait cette révélation, comprenne que le paradis nous attendait au bout si l’on se pliait simplement aux règles, à ce cadre créé par Allah et révélé par le Prophète. C’était si simple, si clair, limpide même…
Je voulais en avoir plus, savoir comment je pouvais changer ce monde, et le rendre meilleur. J’ai interrogé l’imam, mais il s’est vite retrouvé à court de réponses. Je me suis alors tourné vers plusieurs croyants, ai longuement parlé avec un groupe de fidèles. Ce groupe, il était plus investi que les autres, ses membres étaient différents, ils avaient un je-ne-sais-quoi de plus, dans leur manière de parler, de prier qui me faisait penser qu’eux pourraient me révéler d’autres pans de cette histoire passionnante.
Ils étaient quatre, Abdelali, Hadi, Mandhur et Zahid. En parlant avec eux, j’ai appris de nombreuses choses. J’ai appris comment mieux prier, comment observer scrupuleusement les ordres du Coran et comment me plier à la volonté de Allah, le servir du mieux que je pouvais. Ils m’ont dit que j’apprenais vite, que je serais bientôt un bon musulman, qu’il ne fallait pas que je laisse la tentation du péché me submerger.
Je passais mes journées avec eux. Je leur racontais ma vie, ma famille, le chômage chronique de mon père, ma mère qui nous ramenait un peu d’argent en faisant des ménages et qui en même temps payait du mieux qu’elle pouvait les études de ma sœur, comment mon frère et moi on « récupérait » deux-trois trucs pour les revendre et pouvoir aider un peu la famille. Eux me parlaient de Allah, des traditions et de l’orient, de la Syrie, de la guerre souvent, de quelques-uns de leurs amis qui étaient partis là-bas pour aider la population à se défendre, et comment ils les enviaient d’avoir l’occasion d’aider à l’établissement d’un bon état musulman.
J’ai commencé à me disputer de plus en plus souvent avec Yanis. Lorsque je lui racontais ce que j’avais appris, ce que je comprenais enfin, mon envie de changer ce monde, il me regardait avec tristesse et disait : « Mon ami, es-tu sûr que tu as bien compris les enseignements de Dieu ? Il s’agit d’organiser ton monde intérieur, de donner un cadre à tes propres agissements pour ton propre bien, le paradis attend ceux qui sont bons, pas ceux qui forcent le monde à leur ressembler. L’islam est une lumière, pas une prison. » Puis, voyant que je ne changeais pas d’avis, il se replongeait dans son livre, et je retournais de mon côté de la chambre.
La prison, j’en sortirais bientôt, le temps passait plus vite à présent. Mes nouveaux amis m’ont conseillé de ne plus parler à Yanis qui, selon eux, ne comprenait rien à la grandeur de Dieu. J’ai suivi leur recommandation.
La libération de Hadi était prévue une semaine avant la mienne. J’ai appris qu’il habitait pas loin de chez moi, nous avons donc décidé de nous revoir dès que je serais libre.
J’ai attendu, et je me suis tenu à carreau, histoire d’éviter qu’on ne m’offre de rester un mois de plus. Et lorsque le jour est enfin arrivé, lorsque les grandes portes métalliques qui bouchaient mon horizon se sont refermées derrière moi, Ka-schlank !, me laissant seul en dehors de ces murs brunâtres, j’ai senti un bonheur immense m’envahir. J’avais une mission à accomplir, un but à poursuivre et une loi qui me disait comment y arriver.
C’est ma mère qui est venue me chercher. Je n’ai pas dit un mot du trajet, elle non plus. Il y avait une espèce d’atmosphère lourde dans l’habitacle de la vieille voiture familiale.
À peine arrivés dans le minuscule appartement où nous vivions, elle, moi, mon père et ma sœur aînée et mon petit frère, j’avais l’impression de ne plus être chez moi. Les pièces encombrées de photos m’oppressaient, je suffoquais. Quand mon père m’a demandé comment j’allais, je me suis efforcé de sourire et de lui répondre que tout était en ordre, mais dès que j’ai eu un instant de libre, je me suis échappé pour retrouver Hadi.
On s’est rencontrés dans le même parc où j’avais l’habitude de voir mes anciens amis, mais étonnamment, je n’en ai croisé aucun. Je lui ai expliqué que je ne me sentais plus à ma place chez mes parents, que j’avais besoin de faire quelque chose de signifiant, de grand.
- Je pense que tu es prêt », m’a-t-il dit.
- Prêt pour quoi ? », me suis-je interrogé. Il a sorti un bout de papier de sa poche. Dessus, il y avait une adresse internet griffonnée au stylo-bille.
- Tu y trouveras toutes les informations qu’il te faut, lis tout ce que tu trouveras et appelle-moi à ce numéro lorsque tu auras décidé ce que tu veux faire.
Il a noté son numéro de portable sur le papier puis est parti, sans oublier de glisser un « Allah Akbar ! », Dieu est grand, dans ses salutations.
En arrivant à l’appartement, je me suis jeté sur mon téléphone et ai entré l’adresse fournie par Hadi dans le navigateur.
Des images de drapeaux noirs, d’hommes encagoulés, d’armes de toutes sortes. Et toujours, cette intention : « Nous sommes les envoyés de Allah, obéissez aux soldats du Tout-Puissant ! ». Cela n’était jamais explicitement dit, mais c’était toujours l’idée derrière les images. J’ai commencé par avoir peur, par avoir envie de laisser tout tomber là. Mais, me reprenant, j’ai plongé plus avant dans les pages internet. Petit à petit, je comprenais où voulaient en venir ces hommes. Les infidèles et les pécheurs ne seront jamais heureux de voir leur monde pourri s’évanouir pour laisser place à la Charia, la vraie loi de Allah. Il fallait bien que quelqu’un s’occupe de ces gêneurs, si l’on voulait étendre le califat. Il n’y a pas de révolution sans renversement. Il fallait bien des soldats qui par leur engagement, gagneraient forcément leur place au Paradis. Il n’y avait pas de plus belle récompense.
Lorsque j’ai estimé avoir assez lu, j’ai fermé les yeux. Ma destinée se trouvait devant moi. J’ai souri. Tout allait changer.
Les jours suivants, j’ai beaucoup parlé, via le site à d’autres personnes qui étaient parties avant moi. « C’est comme des vacances ! » « Ma foi a enfin trouvé un but !» « Je n’aurais jamais imaginé pouvoir servir Allah à ce point ! » Tous étaient élogieux et enthousiastes. J’ai appelé Hadi pour lui faire part de ma décision. Je partirais. J’irais apprendre à me battre au nom de Allah, je participerai à l’édification de ce monde régi par Allah! Il a prévenu de ma part un de ses amis qui pourrait m’amener à l’aéroport.
Je suis parti au milieu de la nuit sans prévenir personne. Je n’ai laissé qu’un billet sur mon lit, disant à ma famille que je priais pour eux, et que inch’allah, je reviendrai à la maison une fois ma mission accomplie.
D’abord, j’ai marché un bout de chemin, mon sac sur le dos. Dedans, il n’y avait que le strict minimum. Quelques habits de rechange, une brosse à dents, mon portable et de l’argent.
J’ai rejoint le point de rendez-vous que m’avait fixé l’ami de Hadi. Il m’attendait comme prévu dans un monospace gris métallisé. C’était un homme gras, aux yeux noirs et à la peau luisante. Il portait une chemisette bleuâtre et un bermuda blanc. Posé sur le siège conducteur, il sirotait un café tiède dans un verre en carton. « Tu es en retard… » ont été les seuls mots qu’il m’a adressés. Je me suis assis sur le siège passager sans dire un mot et il a démarré la voiture. Pendant le trajet, il m’a passé l’enveloppe qui contenait le billet d’avion et le carnet d’adresses. Je l’ai fourrée dans mon sac. J’avais la tête embrumée de sommeil et n’avais qu’une seule envie : dormir. Après tout, il était trois heures du matin.
On est arrivés à l’aéroport. J’ai passé la douane sans problème. Je suis monté dans l’avion. Et il a décollé.
Je suis parti.
Là-bas, c’était entraînement. L’entraînement par la prière et la course. On nous dresse à devenir de bons combattants. Là-bas, j’ai adopté ma nouvelle identité, mon nouveau nom. J’ai choisi Abdelfattah, le serviteur de Celui qui ouvre. Celui qui ouvrira la voie vers un monde plus beau. J’ai appris l’arabe, j’ai appris comment m’habiller, comment parler, j’ai laissé pousser ma barbe et ai cessé de répondre aux messages que ma mère m’envoyait tous les jours.
Je suis revenu.
Sept mois ont passé. Je suis un autre homme maintenant. Dans ma valise, une clef USB avec les plans d’une bombe artisanale que je pourrais fabriquer une fois en France. Je la cacherai dans un sac, et ne l’enclencherai que lorsque je n’aurai plus d’autre choix. J’ai la clé d’un local dans lequel sont stockés quelques fusils et du matériel qui pourrait également m’être utile. Gilet pare-balles, munitions, grenades, un véritable arsenal caché dans un garage en plein centre de Paris.
Avant de partir, j’ai rasé ma barbe, histoire de ne pas me faire remarquer dans un pays où la plupart des hommes la trouvent inesthétique. J’ai eu un moment de sueurs froides à la douane. Avais-je été repéré par les autorités ? Allaient-ils m’arrêter ? Analyser ma clef USB ? Rien de tout cela, je suis passé sans encombre.
Je loge dans le studio de Zahid, sorti de prison entre temps. Il est bien situé, à deux rues de ma cible, une synagogue dont le rabbin a insulté Allah en traitant le Califat d’ « institution monstrueuse et sans fondement ». Notre vengeance s’abattra sur lui et son infâme communauté. Et il servira d’exemple à ce pays qui se croit tout permis.
Demain après-midi, c’est demain après-midi que je passe à l’action. Zahid m’a aidé à tout préparer, et il pilotera la voiture jusqu’en face de la synagogue. Ensuite, je serai seul.
On se lève tôt, pour être sûrs de ne rien oublier. On mange rapidement un morceau de pain avant de nous laver sommairement. On prépare la bombe que je glisserai dans mon sac à dos. Un peu d’alcool, un peu d’essence, un détonateur maison, de la poudre et un interrupteur qui pendra sur mon épaule depuis la bretelle. Je regarde par la fenêtre, le ciel est nuageux, mais un rayon de soleil solitaire perce le plafond gris, comme si Allah nous encourageait dans notre action. Il nous en sera reconnaissant, c’est sûr. Et même si nous échouons, si on m’abat ou que je dois faire exploser la bombe, je mourrai en martyr, et le paradis sera là pour m’accueillir. Non, je ne risque rien.
Nous sommes prêts, dans la voiture, une Kalachnikov, classique, emballée pour l’instant dans une couverture, trois lourds Beretta, avec chacun un chargeur de rechange. Avec toutes ces munitions, nous aurons largement de quoi accomplir notre mission, et montrer au monde la puissance d’Allah !
Avant de partir, je veux prier, pour être protégé, pour être reconnu, pour que Zahid ne soit pas arrêté, pour que je ne souffre pas trop longtemps si je dois mourir.
On embarque dans la voiture, ces préparatifs nous ont pris toute la matinée, nous devons agir dans l’après-midi, vers deux heures, heure à laquelle a lieu la prière dans cette synagogue.
Nous roulons un moment, en observant bien les alentours, prêts à s’éclipser au cas où une voiture de police nous remarquerait. La voiture est banale, noire, d’une marque française. Nous avons maculé la carrosserie et la plaque d’immatriculation de boue, pour la cacher, et en cas de poursuite, il nous suffira de trouver quinze minutes pour tout nettoyer et nous fondre dans la circulation dense de Paris.
Nous nous arrêtons un instant dans une rue peu fréquentée, si ce n’est déserte, et mettons en place les dernier détails. On sort le fusil des couvertures. Je glisse un Beretta dans mon pantalon, Zahid garde les deux autres au cas où il aurait besoin de se défendre. J’enfile un gilet pare-balles et fourre une grenade dans ma poche. Je me rassois sur le siège passager et garde une cagoule noire à la main. Zahid me passe la Kalachnikov, que je pose sur mes genoux, et la cache avec le sac à dos piégé. Nous repartons.
On roule encore un petit moment. Les enseignes des magasins se succèdent, on est dans un quartier plutôt joli, dommage qu’il soit rempli de Juifs.
Nous sommes arrivés devant la synagogue, je suis un peu nerveux. Vais-je bien accomplir ma mission ? Je n’ai jamais tué qui que ce soit après tout, jusqu’à maintenant, ce n’était que de l’entraînement. Je doute, je ne suis pas sûr d’être véritablement prêt. Haaaa ! Si je faisais tout capoter ! Tout le monde m’en voudrait !
Remarquant mon trouble, Zahid sort un petit sachet en plastique transparent du vide-poche. Il contient une vingtaine de petites gélules blanches. Il ouvre le sachet et m’en tend une. « C’est quoi ? », je lui demande en la prenant dans ma main. « Vitamines, tu te sentiras mieux après ». J’avale la gélule. En trente secondes, je sens mon cœur qui s’accélère, ma vision devient plus précise, plus nette, j’entends tout ce qui se passe autour de moi. Je me sens bien, je me sens fort, je suis fort. Je remercie Zahid. Je sors de la voiture, après avoir enfilé ma cagoule. Un pas sur la route, un sur le trottoir, un sur le palier, au cinquième pas je suis dans le bâtiment. J’entre en hurlant « Traîtres ! ». J’appuie sur la gâchette du fusil et les balles crépitent, leur bruit faisant écho à mon cœur qui s’accélère encore. On crie dans la pièce, je vois des gens qui s’effondrent, au milieu, un homme d’une cinquantaine d’années, un gros bouquin à la main, est figé sur place. Il porte une cravate et un costume, avec une espèce de grosse écharpe blanche. Je le reconnais, c’est celui des photos. Je pointe mon canon sur lui et fait feu. Il tombe lentement dans un bruissement de tissu, une tache rouge sur son habit. Je tire encore, un peu au hasard, en avançant pas à pas entre les rangées de sièges en bois. Taktaktaktaktak ! fait la Kalachnikov. Les gens crient, des hommes, des femmes. Puis je tombe à court de munitions et décide que j’ai donné déjà assez d’importance à mon message. Je cours vers la porte, en faisant bien attention de ne pas glisser dans les flaques de sang dont monte une odeur écœurante. Juste avant de sortir, je fais volte-face et crie aux animaux apeurés cachés derrière les colonnes et les sièges « Il n’y a de dieu que Allah ! Allah Akbar ! Repentez-vous ou mourez ! ». Je tire mon pistolet de ma ceinture et tire deux coups en l’air pour appuyer mon propos, puis je sors en courant.
Zahid est là, la portière passager est ouverte et je saute sur le siège alors qu’il démarre en trombe, faisant crisser les pneus de la voiture. Les passants sur les trottoirs fuient dans la direction opposée à la nôtre. Au loin, j’entends déjà les sirènes de police qui hululent. J’allume la radio, sur la chaîne des infos. Je souris en voyant qu’on parle de nous, j’ai été efficace, on dirait.
La voiture est moins rapide que ce que nous avions prévu. Je sors de nouvelles munitions pour la Kalach’, au cas où on aurait besoin de s’en resservir. J’ai encore ma grenade et ma bombe, quinze balles dans le Beretta, Zahid n’a pas tiré, il lui reste donc trente-deux coups avant de devoir recharger avec les munitions dans ses poches. Je jette un œil au rétroviseur, derrière, il y a trois voitures blanches et bleues qui nous poursuivent. La police, ils sont déjà trop près.
On fonce, on fonce mais de plus en plus la police se rapproche. La radio conseille aux gens de s’éloigner de la zone où nous sommes. La route se vide petit à petit. Parfois, on voit des gens se pencher à la fenêtre et regarder passer notre voiture suivie de celles des policiers.
On passe le signalement de notre voiture à la radio, et les journalistes ne doivent pas être très loin derrière les policiers.
On tarde pas à passer le périph’, et on continue à rouler, en choisissant de plus petites rues, en prenant des chemins détournés, essayant de semer la police. Un moment, on ne les voit plus derrière nous. On se permet de souffler un peu, pas plus de trois minutes, et on redémarre. Il nous faut un endroit où nous cacher. Et vite. Tout de suite même.
Là ! Sur le côté ! Une librairie ! On pourra se cacher là ! Nous descendons de la voiture en catastrophe et courrons vers le magasin. Un instant, je vois mon reflet dans la vitrine. Cheveux en bataille, sale, les vêtements tachés. J'ai des énormes cernes sous les yeux et mes pupilles sont gigantesques. Je ne sais pas si je ressemble à un héros ou à un fugitif, sans doute un peu des deux. Nous entrons, armes à la main, il n’y a aucun client, juste un vendeur, un jeune blondinet avec une écharpe verte, derrière le comptoir, je pointe mon Beretta sur lui et lui fait signe de nous suivre. Il obéit, l’air complètement terrifié. Zahid l’attache à une chaise avec son écharpe pendant que je déplace des meubles pour nous protéger tout en gardant la porte en ligne de mire. Bien sûr, la police finit par arriver devant la vitrine, sirènes hurlantes. Ils doivent se douter que nous avons un otage, qui d’ailleurs pleure doucement sur sa chaise. Pathétique.
Dehors, on entend un mégaphone nous hurler de nous rendre. On a pas vraiment le choix, quelque part, en se mettant à l’abri, on s’est coincés nous-mêmes dans cette fichue librairie. Il faut que l’on décide quoi faire. Je pense que la police ne voudra pas attaquer le magasin tant qu’un otage sera en jeu, mais on est jamais sûr avec ces fils de chien.
Après une longue discussion, nous décidons d’un plan. Nous allons tenter de sortir de ce piège à rats, et faire en sorte que ces imbéciles ne puissent pas nous suivre.
On détache l’otage. Zahid le tient fermement par le bras et garde le canon de son arme sur sa tempe. Je prends ma grenade à la main et mon sac à dos piégé n’est plus que sur une de mes épaules. Nous allons tenter de sortir. À travers la vitrine, on doit nous voir avancer vers la porte, parce que quand on la pousse, tous les policiers nous ont en joue. Rapidement, nous nous abritons derrière notre voiture, qui est juste devant la sortie. Les pneus sont crevés, on ne peut pas l’utiliser pour se faire la belle. On est complètement encerclés, après la voiture, c’est une ronde de véhicules qui nous bouche le passage. Il faudra d’abord créer un passage au-travers, et ensuite, nous pourrons fuir. Je risque un œil à travers les vitres de la voiture. D’une main, je serre la grenade dans ma main et tire la goupille. Je compte jusqu’à trois avant de la lancer contre le mur de policiers. J’entends des cris, des bruits de pas précipités, une explosion qui fait trembler la voiture. Immédiatement après, j’enclenche l’interrupteur de ma bombe artisanale et lance le sac au même endroit que la grenade. Une explosion encore plus forte, j’ai mal aux tympans, un souffle chaud. On laisse l’otage, il nous encombrerait, ainsi que la Kalachnikov, trop lourde, et on court vers la trouée, profitant de la confusion et de la fumée qui nous cache. Des balles sifflent près de mes oreilles. J’ai mal à la tête, mes yeux me brûlent, mes poumons toussent, mais je continue à courir. Je sens un choc dans mon tibia gauche, je m’encouble, je tombe. Une onde de douleur remonte ma jambe, inonde mon corps. Ça me donne envie de vomir. J’ai mal. J’essaie de me relever, trébuche, retombe. J’ai mal. Je crie, une seconde balle vient se loger dans mon dos. Je crie encore, mes yeux pleurent. Je vois Zahid me jeter un regard désolé avant de continuer à courir. J’ai mal. Je sens mon sang sortir de ma blessure, chaud et visqueux. Il y a trop de sang, trop.
Je me roule en boule en proférant des malédictions. De plus en plus de sang qui coule, je sens mon énergie s’estomper, mes forces me quitter. J’ai envie de dormir. Non… Pas maintenant… Il ne faut pas que je ferme les yeux. J’entends un bruit sourd et régulier, partout autour de moi. Je comprends que c’est mon cœur, qui tonne dans mes oreilles, qui pousse le sang hors de mon corps. J’ai moins mal, maintenant. Mes yeux sont troubles, je tousse, du sang est mélangé à ma salive. La poussière est retombée autour de moi, je vois des formes blanches qui s’agitent, des lumières, des flashs bleus et des taches noires qui grandissent. Je n’entends plus mon cœur, tant il bat faiblement. Ma poitrine est silencieuse, j’ai oublié que je devais respirer. J’essaie d’aspirer un peu d’air, c’est du sang qui coule dans mes poumons. Ma vision est presque totalement noire maintenant. J’ai le sentiment de flotter dans du coton, j’ai envie de me blottir dedans, bien au chaud. Mes paupières retombent doucement. Tout l’air de mes poumons se ménage un chemin vers ma bouche, formant de petites bulles roses entre mes lèvres, et je ne bouge plus.
Je crois que je me suis endormi, je ne ressens plus rien.
Cette vie-là est terminée, on dirait. Il est allongé sur le sol, on dirait une tache noire et rouge sur le béton. La scène, vue du dessus est assez intéressante. Je vois le complice maintenu par trois policiers un peu plus loin, et le libraire qui est embarqué par une ambulance. J’en ai pas mal appris avec ce M. Carlin. Au final, c’est simplement un garçon lambda qui voulait faire un monde meilleur. Ce sont ces autres prisonniers, ces recruteurs qui l’ont ainsi reprogrammé. Ce recruteurs qui eux-mêmes ont été détournés vers la voie de la violence à un moment de leur vie, par la génération précédente de radicalisés. Je vois, un cercle vicieux, c’est ça ? Oui, on en voit souvent, c’est simplement qu’il est facile d’embrigader des gens comme ce garçon, qui n’ont plus grand-chose à perdre et qui n’ont ni but ni espoir d’en avoir un, parqués dans ces HLM pourrissants. Pourquoi aujourd’hui et pas il y a vingt ans ? Simplement parce que les méthodes de radicalisation des extrémistes se sont modernisées, ils parlent à la jeunesse avec son langage, par son moyen de communication, les réseaux sociaux et Internet en général. Ils profitent de cette période de doute et de révolte qu’ont la majorité des adolescents pour leur bourrer le crâne avec leur idéologie. C’est vicieux, c’est efficace.
Aurais-je pu faire quoi que ce soit pour cet homme ? Seule, sans doute rien, après tout, en ce moment, je ne suis qu’une sorte d’ectoplasme parasitaire à la recherche d’un nouvel hôte. Mais en tant qu’humain, que pourrais-je faire ? Me lever pour aider ces banlieusards qui crient leur détresse, lever le voile d’incompréhension et de peur qui les entoure, aider à leur donner accès à des échappatoires, à une raison de vivre. Une passion, un métier intéressant, qui les aiderait à sortir, eux et leur famille, de l’indifférence et de la résignation. J’aimerais que ceux qui hier avaient peur de ces « bandes de jeunes » errants puissent demain leur tendre la main.
Je suis peut-être idéaliste ou naïve. Tout cela ne se fera pas en sept jours. En réalité, il faut bien plus pour construire un pont entre deux mondes. Mais j’ai espoir qu’à l’avenir, on ne se contentera pas de passer une jolie couche de peinture sur les murs tagués et d’armer encore plus les policiers. Ce serait se voiler la face, et c’est inutile.
La suite ici
Dommages collatéraux ou le curieux voyage d'un ectoplasme #1
- Le 03/02/2016
- Commentaires (0)
- Dans Historiettes
Hey!
Ceci est le texte que j'ai écrit pour mon travail de maturité. Je le publierai en plusieurs fois, puisqu'il est plutôt long \(´ε` )/
Cette histoire traite de plusieurs personnages impliqués dans un conflit contemporain: celui qui déchire la Syrie depuis cinq ans, et dont les ramifications remontent jusqu'en occident. Aujourd'hui, ce n'est uune petite introduction, histoir de vous donner un peu la hype...
Mon véritable nom apparaissant dans le texte, je l'ai remplacé par mon pseudo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette mineure modification ლ(´A`ლ)
Je vous souhaite une bonne lecture ᕕ( ᐛ )ᕗ
____________________________________________________
Dommages Collatéraux
ou
Le curieux voyage d’un ectoplasme
Partie 1
J’aurais pu naître autre, ne pas porter le nom que j’ai aujourd’hui, simplement être une personne différente. Seul le hasard a fait que je suis aujourd’hui une jeune citoyenne suisse vivant dans une jolie maison, sans problème plus grand que celui de boucler un travail à temps pour l’école ou de devoir rattraper une série télévisée découverte en milieu de diffusion.
Oui, je dois avouer, j’ai eu plutôt du bol, une sacrée chance de cocu même. On ne cesse de me le rappeler, depuis toujours. « Finis ton assiette, pense aux petits Africains qui meurent de faim ! », « Toi, tu as le droit d’aller à l’école ! Et tu ne travailles pas à faire des tapis toute la journée, payée d’un franc à la fin du mois ! »
Super. Vraiment génial. Je dois être la plus heureuse du monde, je ne meurs pas de faim et je vais à l’école. Youpie ! Hourra pour l’occident ! Je ne connais ni la guerre ni l’esclavage, c’est super. Rien. Rien de rien du tout, que j’y connais, même !
C’est là qu’il est le problème. Voilà. Je suis juste une autre ignorante, aveuglée par ma chance.
Mais il y a une chose que je peux faire contre l’ignorance, c’est chercher et apprendre, et si cela me permet de savoir, alors je pourrai peut-être même les comprendre, ces autres humains, ceux qui ont vécu des choses dont je n’aurais même pas soupçonné l’existence si je n’avais pas pris conscience de cette tendance que l’on a dans nos régions à s’engluer dans l’autosatisfaction.
À quelques heures de voiture de chez moi, il y a des gens qui se noient en voulant simplement toucher du doigt une ronde d’étoiles sur fond bleu.
À quelques heures de train, il y a des foules compactes, hommes, mais surtout femmes et enfants, qui se pressent contre un mur surmonté de barbelés, car on leur avait dit qu’il y avait un trou dans la barrière à cet endroit-là. Déçus, ils finiront par marcher sur les autoroutes.
À quelques heures d’avion, il y a des gens qui meurent, se sacrifiant pour ce qu’ils croient juste, mais qui, au final, sont tous plus manipulés les uns que les autres par la soif de pouvoir de quelques beaux parleurs.
Je suis désolée. Tout cela ne me rend pas heureuse.
J’aurais pu être n’importe laquelle de ces personnes. J’aurais pu naître autre, ne pas porter le nom que j’ai aujourd’hui. Et quel meilleur moyen que l’imagination pour voir ce que j’aurais pu devenir ?
D’abord, il faut choisir un bon gros bocal, en verre transparent de préférence, pour être sûr de bien reconnaître ce qu’il y a dedans. Ouvrir le bocal. Prendre une longue inspiration, profonde, remplir ses poumons jusqu’à ce que l’air ait envahit chaque cellule de mon corps, chaque recoin de mon être. Ensuite, expirer, souffler tout l’air dans le bocal, fort, en sortant mes peurs, mes envies, mon apparence, ma date de naissance, toute mon identité, tout souffler dans le bocal, laisser tout cela en sécurité pour plus tard, si jamais j’en ai besoin un jour, mon moi actuel sera là-dedans, d’accord ? Coller une étiquette avec « Essence de Pastèk » écrit dessus.
Une fois que l’on a tout laissé de côté, prendre sa plume. Ou son clavier, mais la plume donne tout de suite un style plus dramatique à celui qui la tient. Prendre la plume donc, la poser sur le papier et les yeux sur les bases du personnage que l’on a commencé à construire. Un nouveau nom, une vague époque, un environnement. Alors là seulement inspirer à nouveau, et se laisser porter par ce souffle jusqu’à une personne encore inconnue que l’on s’approprie.
Se laisser porter, là je cherche d’abord aux alentours. Il ne se passe pas grand-chose en Suisse. On va aller voir plus loin, suivez-moi donc. On survole une frontière, quelques villes, des champs avant d’arriver vers une banlieue quelque part entre la ruine et la peinture fraîche.
Là ! Oui, juste là, caché derrière cette voiture. Vous le voyez, ce garçon ? Je crois qu’on tient notre premier sujet. Il est en train de loucher sur le sac en cuir de cette femme, là, non ? Oh ! Regardez ! Il le lui a arraché ! Il court entre les barres d’immeuble couleur vieux béton, son butin dans la main gauche. Oups, je crois avoir vu deux policiers au coin de la rue suivante…
Ce type m’a l’air intéressant, non ? Allons-y !
Il se fait attraper, juger, je suis condamné.
Muettes
- Le 29/11/2015
- Commentaires (0)
- Dans Historiettes
Bon. Je comprends que je dois publier.
Un gros morceau en préparation (voire deux, mais ça prendra encore un peu de temps)
En attendant, j'ai fait une sortede crise d'angoisse. Je suis seule chez moi, il est tard et il fait tout nuit. Il n'y a que le bruit de mon ordinateur et celui de mes pensées. Sans m'en rendre compte, ces quelques lignes ont surgit sous mes doigts.
Je vous les livre, je crois que quelque chose ne tourne pas rond chez moi...
Ne prenez pas cela pour autre chose qu'une fiction écrite trop tard le soir. Ce serait malvenu.
_______________________________________________________________
Trop de silence dans ma tête.
Je crie, je pleure
Assourdissant silence qui me méprise de toute son oppression
Tension qui vibre, senteur de sang
Histoire de nerf qui craquent, claquent, lâchent
Silence !
Faites taire ces voix dans mon esprit
Résonnent dans le silence
Cristal bouillant, gélatine tiède
Empêtrée dans un lac de pensées incohérentes
Stop
Non
Trop de volutes incompréhensibles
Je crie dans le vide
Vomissant encore le silence
Gorge serrée, pierres sur la carotide
Froid et panique
Une angoisse profonde dans ce monde agité
Faites taire les voix muettes dans ma tête
Elles me rappellent toutes les erreurs du passé, me pressent de les oublier
De m’oublier
D’être oubliée
Un grand bruit et tout sera fini
Un trait de feu et le sang coulera
Je retrouverai la quiétude salée de l’insouciance
Non
Je ne veux plus vivre ce silence
Dormez, bonnes gens!
Il est deux heures et tout va bien!
Dormez!
Et oubliez la lucidité du soir
Petit Con
- Le 12/03/2015
- Commentaires (0)
Il fut un temps où je ne parlais presque pas, lorsque j’avais autour de 13 ans. C’était il y a peu de temps tout de même. Toujours est-il que j’étais toujours renfermée sur moi-même et très souvent seule. Qui aurait pensé qu’une huître telle que moi pourrait être remarquée par les personne qui pouvaient lui faire le plus de mal au monde ?
Ceci n’est pas un auto-apitoiement, je raconte simplement cette partie de mon histoire qui, malgré son apparente futilité, a marqué ma personnalité pour toujours. Bien entendu, je m’expliquerai aussi sur les leçons que j’ai tirées de cette mésaventure.
Je disais donc que vers mes 13 ans, j’étais très solitaire. Je ne parlais à personne, personne ne me parlais et c’était très bien comme ça. Je faisais alors du cirque (j’en ai toujours été passionnée et pratique ce noble art encore aujourd’hui). Ma spécialité, en fait la seule discipline que je sois capable de maîtriser convenablement, est et a toujours été le monocycle. Ce véhicule me donnait du fil à retordre puisque je ne parvenais pas à exécuter une certaine figure (rouler avec un seul pied).
J’ai donc décédé d’utiliser le monocycle pour me rendre à l’école et de m’entraîner aux pauses disponibles. C’est là que mes problèmes ont commencé. De fantôme, je suis passée à « la fille qui vient à l’école en monocycle » et de cette dernière à « la fille bizarre qui est tout le temps seule, vous savez, celle qui se ramène en monocycle à l’école ».
Bref, je suis devenue connue. Et pas du bon côté de la célébrité. Voyant que mes armes sociales étaient peu affutées, de petits parasites se sont accrochés à mes basques. Chantant cette horripilante mélodie circassienne à chaque fois qu’ils me croisaient dans les couloirs, s’asseyant à mes côtés pour se moquer de moi dès qu’ils en avaient l’occasion, m’entourant de leur méchanceté, ces quelques gosses d’un an mes cadets n’étaient que celui de mes soucis. En effet, un mal bien plus insidieux m’avait dans le collimateur.
Ce garçon, apparemment intelligent et vif d’esprit, encore et toujours mon cadet d’un an, avait on ne sait pourquoi décidé en compagnie de son acolyte de me harceler d’une toute autre manière. Sa principale méthode d’attaque était de me jeter au visage quelque allusion sexuelle si j’avais le malheur de croiser son chemin. Pour une Sans-Amis comme moi, s’entendre ainsi chuchoter de telles choses était impensable. Tout cela était si étrange et incompréhensible pour moi que j’en vins même à douter de mes sentiments à l’encontre de cet individu. Sentiments qui ne dépassèrent jamais l’état de doutes bien entendu.
Il se trouve que le mardi de la semaine précédant les vacances d’hiver de l’an de grâce 2012, le gosse et son acolyte me harcelèrent plus que de coutume, ainsi que tous les autres imbéciles précédemment décrits. Pensant trouver dans la bibliothèque de l’école un lieu sûr où me réfugier, je m’y précipitai. Et là, les deux compères firent irruption dans la pièce. Avec à peine un regard malfaisant dans ma direction, ils empruntèrent un crayon à la sympathique bibliothécaire chargée de ce temple de l’imaginaire que sont les étagères ployantes de livres. C’était un crayon bleu-violet.
Ils s’assirent vers le fond et je les vis écrire quelque chose sur ce papier. Pensant qu’il s’agissait d’un simple devoir, je retournai dans mes lectures, ouïssant à peine les mots « trou noir » et « tuyau ». Aucun intérêt.
Le soir (ou plutôt la fin d’après-midi) arriva enfin. J’allais pouvoir rentrer chez moi et bouquiner peinarde dans mon lit. Mais un évènement vint contrecarrer mes plans lorsque je voulus atteindre mon casier personnel. Devant étaient postés les imbéciles de la musique horripilante, fredonnant. La mélodie incarnant mes pires cauchemars (papa-da padapapa-padam papapa-padapapa-padam-papa-padam papa-padam), un sourire narquois aux lèvres. Une ou deux insultes fusèrent, glissant sur la toile huilée de l’habitude. J’ouvris mon casier et trouvai un papier plié en quatre. Interloquée, je l’ouvris. C’était un message. Il y était question de « coucher avec nous », « se lécher le tuyau et le trou noir » et d’ « « « amour » » ». C’était signé « Les Anonymous ». Le tout était tracé au crayon bleu-violet.
Profondément surprise, choquée, dégoutée et honteuse, je jetai un rapide regard circulaire à mon environnement immédiat. Mis à part le groupuscule chantant, deux silhouettes reconnaissables se planquèrent derrière un coin. Un petit con et son acolyte.
Intensément troublée, je jetai dans un mouvement de panique le mot dans un autre casier (qui ne comportait aucun cadenas) et m’enfuis, les larmes aux yeux.
Le lendemain, l’infâme message était de retour dans mon casier. Je le saisis discrètement et le dissimulait dans une poche de la sacoche qui me servait de cartable, me promettant de parler de cette histoire au médiateur.
Je ne le fis jamais. L’année scolaire se termina, puis l’année tout court, je brûlai le mot en me jurant de ne pas en vouloir à ces gens et d’oublier tout cela. La rancœur n’apporte rien, me disais-je. C’est avec cette sérénité que j’abordai l’école supérieure. 15 ans et un bac à avoir en trois ans (je ne me lancerai pas ici dans l’explication du système Suisse et plus précisément Vaudois en matière de scolarité, ce serait trop compliqué…)
Sereine donc, j’avais presque oublié ma vie d’avant, celle où je ne parlais pas. Je me fis des tas d’amis, et si je ne suis pas très loquace en général, avec eux, le moulin à parole a le vent dans les pales.
Oublié, pardonné, gentille fille.
Sauf que, dans la vraie vie, il ne suffit pas de pardonner aux meschants aux noirs desseings pour en faire de doux agneaux.
J’entamais ma deuxième année lorsque je l’aperçus sur le quai de la gare, attendant un matin le train qui devait nous mener tous deux en cours. Il avait donc réussi, ce salopard, à intégrer l’école des grands ! Sur le moment, la haine et la rage m’envahirent, il fallait que je le tue.
Je me réfrénais à grand peine, me convainquant que les gens changeaient en trois ans, que ce gosse avait mûri, qu’il était à présent un garçon mature et intelligent.
Que nenni ! Voici ce qui se passa !
Un mardi soir, le 19 novembre 2014 pour être précise, voilà que je tombe nez à nez avec un sympathique membre de l’équipe d’improvisation dont je fais partie. Ce dernier était en compagnie de, devinez qui ? Bien évidemment ! Le petit con ! Lequel je salue avec une politesse et un sourire forcés. En guise de réponse, celui-ci me jette : « Tu te souviens du mot dans ton casier ? »
Avec un regard tordu.
Je lui rétorque : « Sais-tu que je n’ai jamais eu autant envie de tuer quelqu’un ? » Puis tourne les talons, poings serrés dans mes poches.
Rage, ressentiment, honte et tristesse m’assaillent à nouveau. Je passe l’heure et le jour suivant à frapper les murs en maudissant ma naïveté et l’incapacité de ce connard à gagner un tant soit peu de maturité. Je me fais mal à force de balancer mon pied contre les parois de béton.
Je hais ce gosse.
Hooo, oui, je le hais…
Je ne lui ai pas reparlé depuis, mais lorsque nos regards se croisent dans les couloirs de l’école, je m’efforce de lui communiquer toute ma haine, et lui, toujours aussi narquois, fait comme si de rien n’était. Je lui ai clairement montré que, dès que je le savais à proximité, j’avais une paire de ciseaux pointus à portée de main.
Puisse-t-il brûler en enfer.
J’espère ne plus jamais avoir à subir le spectacle désolant de son existence. Qu’il crève. Qu’il crève, j’en serai heureuse.
Je ne sais même pas son nom. Enfin, je n’en suis pas sûre… De toute façon, je ne le donnerai pas, je ne veux pas être l’instigatrice d’un mouvement de haine envers ce gamin, même s’il le mérite.
Je me le garde pour plus tard.
Au moindre faux pas, je lui saute à la gorge et je l’étrangle jusqu’à ce qu’il me demande pardon à genoux.
Et il verra à ce moment-là que je ne commets jamais deux fois la même erreur.
Sans Humanité
- Le 16/01/2015
- Commentaires (2)
- Dans Historiettes
Assez… C’en est assez… Tout ce bruit, tous ces gens qui s’agitent, cette tension qui persiste et ne fait qu’empirer, ce sentiment si doux et pourtant si violent qui envahit peu à peu mon corps et mon cœur. Assez, je ne pourrai plus tenir longtemps. Mes muscles se crispent au rythme de ma respiration saccadée. J’ai un goût métallique et sucré dans la bouche. Je n’arrive plus à les ignorer, à faire comme ces ombres autour de moi n’existaient pas, il faut me rendre à l’évidence, elles sont bien réelles. Et elles sont nuisibles, je dois me débarrasser d’elles.
Assez, je ne le supporte plus.
Alors pourquoi continuer à me battre ? Pourquoi ne pas tout lâcher ? Agir enfin comme bon me semble ?
Ce serait trop fort, trop violent, personne n’y survivrait. Je ne peux décemment pas me laisser glisser dans l’inconscience.
Qui se préoccupe de décence dans un moment tel que celui-ci ? Qui voudrait se sacrifier pour un monde qui ne lui a jamais rien offert ? Qui souffrirait seul sa vie durant pour éviter que ses ennemis n’aient à subir cette douleur ?
Je ne sais pas… un humain peut-être ?
Ces fantômes ne sont rien, je vaux mieux qu’eux. J’agirai, je passerai à l’action, je lâcherai ma haine et ma rancœur. Comment des êtres aussi insignifiants ont-ils pu me faire autant de mal. Ces ombres maléfiques, ces spectres malfaisants.
Je les détruirai, tous, tous, tous.
J’ouvre les yeux. Dans la cafétéria de l’école s’entrechoquent des dizaines et des dizaines d’élèves. Peut-être bien une centaine entassée ici à l’heure de la pause. Autant de bouches qui babillent, caquètent, braient et crient. Je m’avance doucement au milieu du brouhaha et porte chacune de mes mains à la manche opposée. Là sont toujours cachés mes ciseaux. Deux paires de ciseaux pointus et aiguisés des heures durant afin de les rendre aussi effilés que des lames de rasoir. Je les sors de leur cachette et les cale confortablement, pointe en haut, dans chacune de mes mains. Personne ne semble me remarquer, parfait.
Je referme les yeux et inspire profondément. Une douce musique résonne dans mon esprit. Je comprends que ce sont le tambour de mon cœur et la flûte de ma respiration qui commencent le chant de ma danse. J’amorce le premier pas de ma chorégraphie, je n’ai pas besoin d’ouvrir les yeux, je devine la position de ma première cible au boucan qu’elle émet et à l’odeur de parfum de luxe qui s’en dégage. Je tournoie, et la déchire, je sens son sang couler le long de mon bras. Ma lame a percé sa gorge et fait gargouiller une fontaine à l’odeur suave.
Toutes les conversations se sont éteintes au moment même où la première créature a cessé de parler. Un silence stupéfait règne un court instant. Puis quelqu’un crie et c’est la débandade.
Moi, je danse à nouveau, je n’écoute pas leurs jérémiades. Je glisse, je tournoie, je découpe et déchire dans la panique que j’ai provoquée. Un sentiment de bonheur pur m’envahit. Enfin, je suis toute-puissante ! Riez ! Riez pauvres fous ! Vous voilà bien sots à présent. Je prends mon élan, pose un pied sur une chaise désertée, puis sur une table haute et m’envole pour atterrir serres en avant telle un aigle sur un corps bientôt inerte. Je continue à tuer. Encore un, un de plus. Un peu plus de sang sur mon corps. Peu à peu, la cafétéria se vide. Et le silence se fait à nouveau, lourd d’une écœurante odeur de sang. J’achève les quelques blessés qui ont étés incapables de s’enfuir. De toute façon, leurs blessures les auraient tués. Je ne compte pas les cadavres, mais je sais qu’il y en a beaucoup et le sol est poisseux et glissant de leur fluide vital. Je me rends compte que celui-ci me recouvre de la tête aux pieds. C’est drôle. Je me lèche les lèvres. Je goûte le sang mêlé de toutes ces ombres disparues et j’aime ça.
Alors les tambours cessent, la flûte se tait. Ne reste que mon rire qui tinte dans la cafétéria déserte. Mon rire qui s’en va au-delà du plafond, résonne dans le ciel et envahit le monde. Je ris et je ris encore, ne pouvant m’arrêter. J’ai mal au ventre à force. Mes yeux se remplissent de larmes tant je ris et je ne peux que me laisser tomber à terre, parcourues de délicieux spasmes de joie pure.
Je ris lorsque la police vient.
Je ris encore quand les infirmiers m’interrogent.
Je ricane tout au long du jugement.
Je ricane encore lorsque mes parents effondrés viennent au parloir.
Je souris en entendant le verdict du jury
Je souris encore dans ma chambre capitonnée.
Puis je cesse. L’euphorie se termine. Le temps n’est plus aux réjouissances. Il va falloir trouver un moyen de tromper l’ennui dans cette grande pièce blanche où je n’ai droit à aucune visite.
Je m‘assois au sol, m’appuie contre le mur et ferme les yeux. Je tente de faire revenir les violents tambours et la douce flûte mais ils paraissent coincés quelque part dans un coin de mon cerveau, refusant de jouer pour moi aujourd’hui. Je tente de me remémorer la scène de mon envol. Mon cœur rate un battement, ça y est ! Je replonge dans ma transe. Je me renverse en arrière et ouvre la bouche tel un poisson hors de l’eau pour trouver mon souffle. Ma respiration siffle. Le concert se fait entendre à nouveau. Ne manque plus que mon rire mais je sais qu’il ne viendra que lorsque j’aurai accompli quelque acte sanglant. Je me balance, perdue dans la spirale ascendante des flûtes et des tambours. Je me sens tellement bien. Je me relève d’un bond, malgré l’entrave de la camisole et me dirige vers la porte capitonnée et verrouillée qui comporte une petite vitre épaisse. Je titube et chancelle jusqu’à appuyer mon front contre le verre frais. Les flûtes et les tambours jouent encore plus fort, encore plus haut.
Je commence à frapper le verre avec mon front. D’abord doucement puis de plus en plus violemment. Bientôt, la petite fenêtre se couvre de mon sang. À la vue du liquide qui coule le long de mes joues, de mon menton et qui finit par goutter sur le sol, absorbé par le capitonnage, je commence à rire. Je ris du monde, je ris du sang, de la petite fenêtre et de cette stupide camisole. Je ris à nouveau ! Encore et encore et je ne sais comment, mais mon rire défait mes liens et ouvre la porte. Je ne sais encore trop de quelle façon, cette euphorie m’offre mes chers et tendres ciseaux pour abattre les infirmiers et policiers. Et encore plus fou, lorsque je fuis les pistolets en atteignant le toit de l’hôpital psychiatrique, mon rire fait grandir dans mon dos deux grandes ailes de douces plumes blanches et soyeuses. Je m’envole sous le regard ébahi des infirmiers et des policiers survivants.
Je ris de leur stupidité.
Je ris encore de ce monde qui était si sûr de pouvoir m’arrêter.
Je ris tant et tant que le son de mon hilarité atteint le ciel et les étoiles. Qu’il fige de terreur le futile monde en-dessous de moi.
Je ris tant que lorsque je fonds sur cette imbécile humanité, elle se désintègre d’elle-même et disparaît sous mes assauts. Les cieux se voilent de sang. Le monde se brouille. Les enfants pleurent leurs parents morts. Alors je les tue eux aussi. Je détruis tout, je brûle les ville et inonde les villages, je dévore le monde et le recrache pour mieux le piétiner et détruire tout ce qui reste, m’acharner sur les débris de ce qui est déjà mort.
À la fin, je suis seule. Comme je l’étais au commencement. Mais je suis toute-puissante à présent.
Je suis comme un dieu. Désormais, puisque j’en ai le pouvoir, je vais reconstruire un monde vierge de ce que je hais et le rendre parfait. Il sera superbe.
Je m’installe confortablement sur un rayon de soleil qui perce le voile de sang et sème quelques graines dans le vent. Je vois les arbres se nourrir des cadavres qui jonchent le sol et devenir grand et beaux. Je vois quelques écureuils dans leurs branches.
Je ricane en voyant un chat en attraper puis en dévorer un.
Je ricane encore lorsque l’hiver fait mourir les petites plantes.
Je souris lorsque le printemps les fait revivre.
Je souris encore. Et encore. Je n’arrête jamais de sourire.
Les tambours se sont adoucis et les flûtes tournoient dans la brise.
Je m’allonge sur un nuage et demande aux oiseaux de les accompagner. Un arc-en-ciel me fait un baldaquin et je m’endors paisiblement.
~°~
Bip… Bip… Bip… Bip.. Bip.. Bip. Bip. Bip Bip Bip. Bip… Biiiiiiiiiiiiiiiip…
La courbe devient une banale ligne plate. Puis quelqu’un éteint l’écran. On met le cadavre encore tiède dans un grand frigo en attendant les funérailles.
Puis on le nettoie, on tente de cacher sa plaie, on lui met de beaux habits et on le coiffe. À la cérémonie, la salle est presque vide. Personne ne voulait rendre hommage à la morte. Personne ne l’aime. Après tout, c’est compréhensible, après tout ce qu’elle a fait, elle ne mérite même pas le nom d’humaine.
Mais l’a-t-elle jamais voulu ?
Accident de Personne
- Le 30/10/2014
- Commentaires (0)
- Dans Coup de Gueule
Sur le quai de la gare, j'attend paisiblement mon train. Quand soudain, une annonce retentit.
-----------------------------------------------------------
Quatre minutes de retard.
Accident de personne.
Qui?
Accident, vraiment?
Suicide?
Pourquoi?
Pourquoi quatre minutes précisément?
Est-ce le temps qu'il faut pour enlever le corps et nettoyer le sang?
Le temps qu'il faut pour effacer toute trace de mort, de désespoir. Quatre minutes et tout reprendra son cours. Sauf pour celui qui a fini en steak tartare..
À présent, "cinq minutes" s'affiche. La levée du corps aurait-elle pris plus de temps que prévu?
Pourquoi?
Il était pas encore tout à fait mort?
Voilà le train. Sans aucune tache de sang. On efface bien. C'est fou comme les détergents modernes sont efficaces! Cinq minutes et un bon détergent pour faire comme si rien ne s'était jamais passé.
Après tout, il faut bien que le train continue sa route! Il ne faudreait pas déranger les clients!Déjà qu'ils râlent pour cinq minutes de retard!
Merde ma réunion, mon rendez-vous, mon cinoche. Et puis, ça veut dire quoi, "accident de personne"? Quelqu'u est mort? Quelle horreur, ho mon Dieu! Qu'ils le débarassent vite! Je suis en retard! Après tout, des gens meurent tous les jours, non?
On aura bientôt oublié. Tout sera effacé.
Et un psy aura un nouveau client. Bah oui, ça se conduit pas tout seul, un train. "J'aurais dû freiner"
Et sur le quai: "J'aurais dû le retenir"
Pourquoi tu l'as pas fait, patate? T'avais bien vu qu'il se penchait au-dessus de voies juste avant que le train n'arrive! Putain, même si je ne pense pas que j'aurais plus bougé.
Et toi qu'a sauté! Espèce d'égoiste! Tu pouvais pas crever en emmerdant moins de monde, non? Nope, t'avais pas de corde et de tabouret, de boîte de somnifères? Une la me de rasoir à la rigueur? ... Ouais, putain d'égoiste. Tu voulais faire ton intéressant mais maintenant, la plupart des gens sont vénère contre toi, tu te rends compte? Tu leur a fait manquer le début de leur cinoche!
Égoiste et vaniteux. "Regardez, je vais sauter et mourir, et vous verrez bien comme je vais vous manquer!"
Nope, j'ai juste perdu cinq minutes.