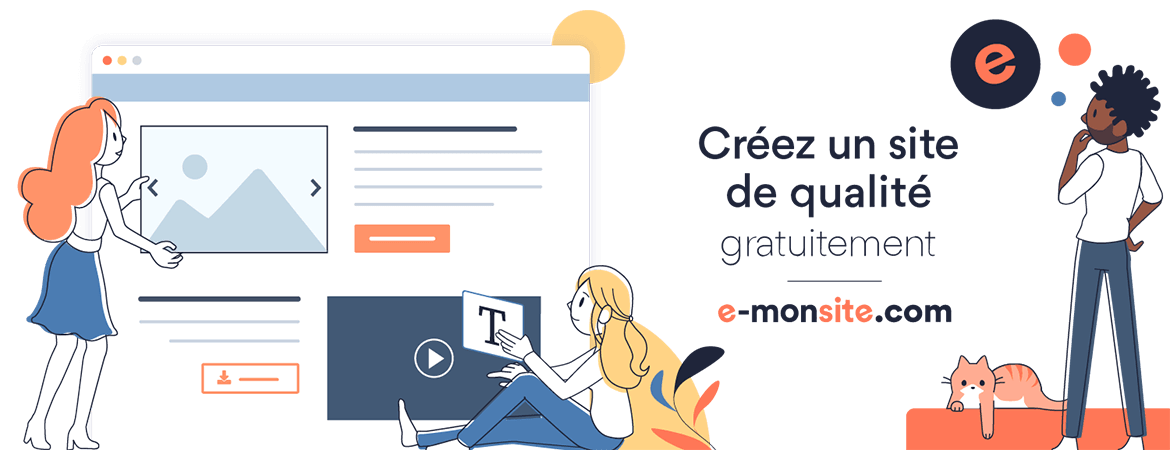Reconstruction
Petit Con
- Le 12/03/2015
- Commentaires (0)
Il fut un temps où je ne parlais presque pas, lorsque j’avais autour de 13 ans. C’était il y a peu de temps tout de même. Toujours est-il que j’étais toujours renfermée sur moi-même et très souvent seule. Qui aurait pensé qu’une huître telle que moi pourrait être remarquée par les personne qui pouvaient lui faire le plus de mal au monde ?
Ceci n’est pas un auto-apitoiement, je raconte simplement cette partie de mon histoire qui, malgré son apparente futilité, a marqué ma personnalité pour toujours. Bien entendu, je m’expliquerai aussi sur les leçons que j’ai tirées de cette mésaventure.
Je disais donc que vers mes 13 ans, j’étais très solitaire. Je ne parlais à personne, personne ne me parlais et c’était très bien comme ça. Je faisais alors du cirque (j’en ai toujours été passionnée et pratique ce noble art encore aujourd’hui). Ma spécialité, en fait la seule discipline que je sois capable de maîtriser convenablement, est et a toujours été le monocycle. Ce véhicule me donnait du fil à retordre puisque je ne parvenais pas à exécuter une certaine figure (rouler avec un seul pied).
J’ai donc décédé d’utiliser le monocycle pour me rendre à l’école et de m’entraîner aux pauses disponibles. C’est là que mes problèmes ont commencé. De fantôme, je suis passée à « la fille qui vient à l’école en monocycle » et de cette dernière à « la fille bizarre qui est tout le temps seule, vous savez, celle qui se ramène en monocycle à l’école ».
Bref, je suis devenue connue. Et pas du bon côté de la célébrité. Voyant que mes armes sociales étaient peu affutées, de petits parasites se sont accrochés à mes basques. Chantant cette horripilante mélodie circassienne à chaque fois qu’ils me croisaient dans les couloirs, s’asseyant à mes côtés pour se moquer de moi dès qu’ils en avaient l’occasion, m’entourant de leur méchanceté, ces quelques gosses d’un an mes cadets n’étaient que celui de mes soucis. En effet, un mal bien plus insidieux m’avait dans le collimateur.
Ce garçon, apparemment intelligent et vif d’esprit, encore et toujours mon cadet d’un an, avait on ne sait pourquoi décidé en compagnie de son acolyte de me harceler d’une toute autre manière. Sa principale méthode d’attaque était de me jeter au visage quelque allusion sexuelle si j’avais le malheur de croiser son chemin. Pour une Sans-Amis comme moi, s’entendre ainsi chuchoter de telles choses était impensable. Tout cela était si étrange et incompréhensible pour moi que j’en vins même à douter de mes sentiments à l’encontre de cet individu. Sentiments qui ne dépassèrent jamais l’état de doutes bien entendu.
Il se trouve que le mardi de la semaine précédant les vacances d’hiver de l’an de grâce 2012, le gosse et son acolyte me harcelèrent plus que de coutume, ainsi que tous les autres imbéciles précédemment décrits. Pensant trouver dans la bibliothèque de l’école un lieu sûr où me réfugier, je m’y précipitai. Et là, les deux compères firent irruption dans la pièce. Avec à peine un regard malfaisant dans ma direction, ils empruntèrent un crayon à la sympathique bibliothécaire chargée de ce temple de l’imaginaire que sont les étagères ployantes de livres. C’était un crayon bleu-violet.
Ils s’assirent vers le fond et je les vis écrire quelque chose sur ce papier. Pensant qu’il s’agissait d’un simple devoir, je retournai dans mes lectures, ouïssant à peine les mots « trou noir » et « tuyau ». Aucun intérêt.
Le soir (ou plutôt la fin d’après-midi) arriva enfin. J’allais pouvoir rentrer chez moi et bouquiner peinarde dans mon lit. Mais un évènement vint contrecarrer mes plans lorsque je voulus atteindre mon casier personnel. Devant étaient postés les imbéciles de la musique horripilante, fredonnant. La mélodie incarnant mes pires cauchemars (papa-da padapapa-padam papapa-padapapa-padam-papa-padam papa-padam), un sourire narquois aux lèvres. Une ou deux insultes fusèrent, glissant sur la toile huilée de l’habitude. J’ouvris mon casier et trouvai un papier plié en quatre. Interloquée, je l’ouvris. C’était un message. Il y était question de « coucher avec nous », « se lécher le tuyau et le trou noir » et d’ « « « amour » » ». C’était signé « Les Anonymous ». Le tout était tracé au crayon bleu-violet.
Profondément surprise, choquée, dégoutée et honteuse, je jetai un rapide regard circulaire à mon environnement immédiat. Mis à part le groupuscule chantant, deux silhouettes reconnaissables se planquèrent derrière un coin. Un petit con et son acolyte.
Intensément troublée, je jetai dans un mouvement de panique le mot dans un autre casier (qui ne comportait aucun cadenas) et m’enfuis, les larmes aux yeux.
Le lendemain, l’infâme message était de retour dans mon casier. Je le saisis discrètement et le dissimulait dans une poche de la sacoche qui me servait de cartable, me promettant de parler de cette histoire au médiateur.
Je ne le fis jamais. L’année scolaire se termina, puis l’année tout court, je brûlai le mot en me jurant de ne pas en vouloir à ces gens et d’oublier tout cela. La rancœur n’apporte rien, me disais-je. C’est avec cette sérénité que j’abordai l’école supérieure. 15 ans et un bac à avoir en trois ans (je ne me lancerai pas ici dans l’explication du système Suisse et plus précisément Vaudois en matière de scolarité, ce serait trop compliqué…)
Sereine donc, j’avais presque oublié ma vie d’avant, celle où je ne parlais pas. Je me fis des tas d’amis, et si je ne suis pas très loquace en général, avec eux, le moulin à parole a le vent dans les pales.
Oublié, pardonné, gentille fille.
Sauf que, dans la vraie vie, il ne suffit pas de pardonner aux meschants aux noirs desseings pour en faire de doux agneaux.
J’entamais ma deuxième année lorsque je l’aperçus sur le quai de la gare, attendant un matin le train qui devait nous mener tous deux en cours. Il avait donc réussi, ce salopard, à intégrer l’école des grands ! Sur le moment, la haine et la rage m’envahirent, il fallait que je le tue.
Je me réfrénais à grand peine, me convainquant que les gens changeaient en trois ans, que ce gosse avait mûri, qu’il était à présent un garçon mature et intelligent.
Que nenni ! Voici ce qui se passa !
Un mardi soir, le 19 novembre 2014 pour être précise, voilà que je tombe nez à nez avec un sympathique membre de l’équipe d’improvisation dont je fais partie. Ce dernier était en compagnie de, devinez qui ? Bien évidemment ! Le petit con ! Lequel je salue avec une politesse et un sourire forcés. En guise de réponse, celui-ci me jette : « Tu te souviens du mot dans ton casier ? »
Avec un regard tordu.
Je lui rétorque : « Sais-tu que je n’ai jamais eu autant envie de tuer quelqu’un ? » Puis tourne les talons, poings serrés dans mes poches.
Rage, ressentiment, honte et tristesse m’assaillent à nouveau. Je passe l’heure et le jour suivant à frapper les murs en maudissant ma naïveté et l’incapacité de ce connard à gagner un tant soit peu de maturité. Je me fais mal à force de balancer mon pied contre les parois de béton.
Je hais ce gosse.
Hooo, oui, je le hais…
Je ne lui ai pas reparlé depuis, mais lorsque nos regards se croisent dans les couloirs de l’école, je m’efforce de lui communiquer toute ma haine, et lui, toujours aussi narquois, fait comme si de rien n’était. Je lui ai clairement montré que, dès que je le savais à proximité, j’avais une paire de ciseaux pointus à portée de main.
Puisse-t-il brûler en enfer.
J’espère ne plus jamais avoir à subir le spectacle désolant de son existence. Qu’il crève. Qu’il crève, j’en serai heureuse.
Je ne sais même pas son nom. Enfin, je n’en suis pas sûre… De toute façon, je ne le donnerai pas, je ne veux pas être l’instigatrice d’un mouvement de haine envers ce gamin, même s’il le mérite.
Je me le garde pour plus tard.
Au moindre faux pas, je lui saute à la gorge et je l’étrangle jusqu’à ce qu’il me demande pardon à genoux.
Et il verra à ce moment-là que je ne commets jamais deux fois la même erreur.
Sans Humanité
- Le 16/01/2015
- Commentaires (2)
- Dans Historiettes
Assez… C’en est assez… Tout ce bruit, tous ces gens qui s’agitent, cette tension qui persiste et ne fait qu’empirer, ce sentiment si doux et pourtant si violent qui envahit peu à peu mon corps et mon cœur. Assez, je ne pourrai plus tenir longtemps. Mes muscles se crispent au rythme de ma respiration saccadée. J’ai un goût métallique et sucré dans la bouche. Je n’arrive plus à les ignorer, à faire comme ces ombres autour de moi n’existaient pas, il faut me rendre à l’évidence, elles sont bien réelles. Et elles sont nuisibles, je dois me débarrasser d’elles.
Assez, je ne le supporte plus.
Alors pourquoi continuer à me battre ? Pourquoi ne pas tout lâcher ? Agir enfin comme bon me semble ?
Ce serait trop fort, trop violent, personne n’y survivrait. Je ne peux décemment pas me laisser glisser dans l’inconscience.
Qui se préoccupe de décence dans un moment tel que celui-ci ? Qui voudrait se sacrifier pour un monde qui ne lui a jamais rien offert ? Qui souffrirait seul sa vie durant pour éviter que ses ennemis n’aient à subir cette douleur ?
Je ne sais pas… un humain peut-être ?
Ces fantômes ne sont rien, je vaux mieux qu’eux. J’agirai, je passerai à l’action, je lâcherai ma haine et ma rancœur. Comment des êtres aussi insignifiants ont-ils pu me faire autant de mal. Ces ombres maléfiques, ces spectres malfaisants.
Je les détruirai, tous, tous, tous.
J’ouvre les yeux. Dans la cafétéria de l’école s’entrechoquent des dizaines et des dizaines d’élèves. Peut-être bien une centaine entassée ici à l’heure de la pause. Autant de bouches qui babillent, caquètent, braient et crient. Je m’avance doucement au milieu du brouhaha et porte chacune de mes mains à la manche opposée. Là sont toujours cachés mes ciseaux. Deux paires de ciseaux pointus et aiguisés des heures durant afin de les rendre aussi effilés que des lames de rasoir. Je les sors de leur cachette et les cale confortablement, pointe en haut, dans chacune de mes mains. Personne ne semble me remarquer, parfait.
Je referme les yeux et inspire profondément. Une douce musique résonne dans mon esprit. Je comprends que ce sont le tambour de mon cœur et la flûte de ma respiration qui commencent le chant de ma danse. J’amorce le premier pas de ma chorégraphie, je n’ai pas besoin d’ouvrir les yeux, je devine la position de ma première cible au boucan qu’elle émet et à l’odeur de parfum de luxe qui s’en dégage. Je tournoie, et la déchire, je sens son sang couler le long de mon bras. Ma lame a percé sa gorge et fait gargouiller une fontaine à l’odeur suave.
Toutes les conversations se sont éteintes au moment même où la première créature a cessé de parler. Un silence stupéfait règne un court instant. Puis quelqu’un crie et c’est la débandade.
Moi, je danse à nouveau, je n’écoute pas leurs jérémiades. Je glisse, je tournoie, je découpe et déchire dans la panique que j’ai provoquée. Un sentiment de bonheur pur m’envahit. Enfin, je suis toute-puissante ! Riez ! Riez pauvres fous ! Vous voilà bien sots à présent. Je prends mon élan, pose un pied sur une chaise désertée, puis sur une table haute et m’envole pour atterrir serres en avant telle un aigle sur un corps bientôt inerte. Je continue à tuer. Encore un, un de plus. Un peu plus de sang sur mon corps. Peu à peu, la cafétéria se vide. Et le silence se fait à nouveau, lourd d’une écœurante odeur de sang. J’achève les quelques blessés qui ont étés incapables de s’enfuir. De toute façon, leurs blessures les auraient tués. Je ne compte pas les cadavres, mais je sais qu’il y en a beaucoup et le sol est poisseux et glissant de leur fluide vital. Je me rends compte que celui-ci me recouvre de la tête aux pieds. C’est drôle. Je me lèche les lèvres. Je goûte le sang mêlé de toutes ces ombres disparues et j’aime ça.
Alors les tambours cessent, la flûte se tait. Ne reste que mon rire qui tinte dans la cafétéria déserte. Mon rire qui s’en va au-delà du plafond, résonne dans le ciel et envahit le monde. Je ris et je ris encore, ne pouvant m’arrêter. J’ai mal au ventre à force. Mes yeux se remplissent de larmes tant je ris et je ne peux que me laisser tomber à terre, parcourues de délicieux spasmes de joie pure.
Je ris lorsque la police vient.
Je ris encore quand les infirmiers m’interrogent.
Je ricane tout au long du jugement.
Je ricane encore lorsque mes parents effondrés viennent au parloir.
Je souris en entendant le verdict du jury
Je souris encore dans ma chambre capitonnée.
Puis je cesse. L’euphorie se termine. Le temps n’est plus aux réjouissances. Il va falloir trouver un moyen de tromper l’ennui dans cette grande pièce blanche où je n’ai droit à aucune visite.
Je m‘assois au sol, m’appuie contre le mur et ferme les yeux. Je tente de faire revenir les violents tambours et la douce flûte mais ils paraissent coincés quelque part dans un coin de mon cerveau, refusant de jouer pour moi aujourd’hui. Je tente de me remémorer la scène de mon envol. Mon cœur rate un battement, ça y est ! Je replonge dans ma transe. Je me renverse en arrière et ouvre la bouche tel un poisson hors de l’eau pour trouver mon souffle. Ma respiration siffle. Le concert se fait entendre à nouveau. Ne manque plus que mon rire mais je sais qu’il ne viendra que lorsque j’aurai accompli quelque acte sanglant. Je me balance, perdue dans la spirale ascendante des flûtes et des tambours. Je me sens tellement bien. Je me relève d’un bond, malgré l’entrave de la camisole et me dirige vers la porte capitonnée et verrouillée qui comporte une petite vitre épaisse. Je titube et chancelle jusqu’à appuyer mon front contre le verre frais. Les flûtes et les tambours jouent encore plus fort, encore plus haut.
Je commence à frapper le verre avec mon front. D’abord doucement puis de plus en plus violemment. Bientôt, la petite fenêtre se couvre de mon sang. À la vue du liquide qui coule le long de mes joues, de mon menton et qui finit par goutter sur le sol, absorbé par le capitonnage, je commence à rire. Je ris du monde, je ris du sang, de la petite fenêtre et de cette stupide camisole. Je ris à nouveau ! Encore et encore et je ne sais comment, mais mon rire défait mes liens et ouvre la porte. Je ne sais encore trop de quelle façon, cette euphorie m’offre mes chers et tendres ciseaux pour abattre les infirmiers et policiers. Et encore plus fou, lorsque je fuis les pistolets en atteignant le toit de l’hôpital psychiatrique, mon rire fait grandir dans mon dos deux grandes ailes de douces plumes blanches et soyeuses. Je m’envole sous le regard ébahi des infirmiers et des policiers survivants.
Je ris de leur stupidité.
Je ris encore de ce monde qui était si sûr de pouvoir m’arrêter.
Je ris tant et tant que le son de mon hilarité atteint le ciel et les étoiles. Qu’il fige de terreur le futile monde en-dessous de moi.
Je ris tant que lorsque je fonds sur cette imbécile humanité, elle se désintègre d’elle-même et disparaît sous mes assauts. Les cieux se voilent de sang. Le monde se brouille. Les enfants pleurent leurs parents morts. Alors je les tue eux aussi. Je détruis tout, je brûle les ville et inonde les villages, je dévore le monde et le recrache pour mieux le piétiner et détruire tout ce qui reste, m’acharner sur les débris de ce qui est déjà mort.
À la fin, je suis seule. Comme je l’étais au commencement. Mais je suis toute-puissante à présent.
Je suis comme un dieu. Désormais, puisque j’en ai le pouvoir, je vais reconstruire un monde vierge de ce que je hais et le rendre parfait. Il sera superbe.
Je m’installe confortablement sur un rayon de soleil qui perce le voile de sang et sème quelques graines dans le vent. Je vois les arbres se nourrir des cadavres qui jonchent le sol et devenir grand et beaux. Je vois quelques écureuils dans leurs branches.
Je ricane en voyant un chat en attraper puis en dévorer un.
Je ricane encore lorsque l’hiver fait mourir les petites plantes.
Je souris lorsque le printemps les fait revivre.
Je souris encore. Et encore. Je n’arrête jamais de sourire.
Les tambours se sont adoucis et les flûtes tournoient dans la brise.
Je m’allonge sur un nuage et demande aux oiseaux de les accompagner. Un arc-en-ciel me fait un baldaquin et je m’endors paisiblement.
~°~
Bip… Bip… Bip… Bip.. Bip.. Bip. Bip. Bip Bip Bip. Bip… Biiiiiiiiiiiiiiiip…
La courbe devient une banale ligne plate. Puis quelqu’un éteint l’écran. On met le cadavre encore tiède dans un grand frigo en attendant les funérailles.
Puis on le nettoie, on tente de cacher sa plaie, on lui met de beaux habits et on le coiffe. À la cérémonie, la salle est presque vide. Personne ne voulait rendre hommage à la morte. Personne ne l’aime. Après tout, c’est compréhensible, après tout ce qu’elle a fait, elle ne mérite même pas le nom d’humaine.
Mais l’a-t-elle jamais voulu ?